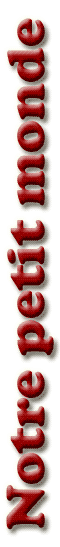![]()
 |
La maison de Jouarre - (Août 1939) |
Clop ! clop ! clop ! En petites sandalettes de toile blanche je saute à pieds joints sur les cailloux du chemin. Je les connais tous, les blancs, les gris, les tordus, ceux qui sont mal plantés dans la terre et qui me font perdre, et les bien dodus, mes préférés, ceux sur qui je peux compter pour gagner... Remonter ainsi le raidillon ombragé qui part du Moulin de Condé pour déboucher sur la Côte de Jouarre, il faut être fou ou n'avoir pas fêté ses cinq ans. Je suis en nage. On ne peut pas dire que mes habits me gênent : une petite culotte de coton rose et une robe à bretelles qui fait une grande corolle quand je tourne sur moi-même. Mais c'est un été exceptionnellement chaud. Alors j'abandonne la partie pour aujourd'hui, mais vendredi jour de marché, j'irai jusqu'en haut Je m'arrête un instant et je ferme les yeux : Je respire lentement et je reconnais les bonnes odeurs de mon chemin. Il se dégage des arbustes et des petites fleurs sauvages un parfum doux et âcre tout à la fois. Je me remets en marche lentement et je cueille un petit bouquet de fleurs violettes et jaunes qui vont très bien ensemble. Je choisis des fleurs à longue queue parce que Maman dit toujours que les tiges sont trop courtes ! Et sans y penser, je débouche sur la route. Je suis éblouie par la chaleur et la réverbération intenses. De l'autre côté de la route, il y a La Maison, la maison de mes Grands-Parents Arthur et Caroline. Elle est extraordinaire, cette maison. Bâtie à mi-côte sur la route qui monte de La Ferté-sous-Jouarre au gros bourg de Jouarre lui-même, tu te demandes comment on a eu l'idée de poser une solide construction sur un terrain pareil. C'est incroyable ! Vue de face, le côté droit est nettement plus haut que le gauche, il faut bien rattraper le dénivelé de la côte. Et si tu observes mieux, tu as la sensation qu'elle colle à la colline : la maison est plus haute devant que derrière. Je traverse la route surchauffée en courant le plus vite possible, sûre de tomber raide sur la chaussée tant le soleil est violent. Je me rue sur la petite porte, reste quelques instants clouée sur le seuil par l'obscurité totale et pénètre enfin dans le frais sous-sol. Je m'habitue à la pénombre. Une faible lampe, haut perchée, promène quelques lueurs dans cette immense salle, quasi déserte. Je nage en plein mystère. Je passe dans la pièce d'à côté. Elle est petite mais un soupirail situé non loin du plafond, court tout le long du mur et lui apporte un peu de clarté. Le long des murs, à mi-hauteur, des clapiers. Nous avons un élevage important de lapins russes, de gros lapins blancs aux yeux rouges. Ils mangent des quantités incroyables d'herbes comme le panais ou le trèfle que nous ramassons à pleins paniers. Il y a aussi le bûcher, le cellier, la cave à vin. Les étagères alignent des bocaux de conserves de légumes et des fruits stérilisés, des confitures de toutes espèces, tout cela étiqueté et daté. " De quoi soutenir un siège" dit Pépé en rigolant. "Il vaut mieux tenir que courir" répond Mémé avec sérieux. Toutes ces pièces sont en dessous du niveau du sol et donne dans le "saut de loup". Le saut de loup est un fossé de cinq ou six mètres de profondeur et de trois ou quatre mètres de large qui court le long de la face gauche de la maison. Je grimpe l'escalier raide et étroit, aux marches trop hautes pour moi ; cela m'oblige à poser un pied sur la marche puis à ramener le deuxième pied à côté du premier, avant d'attaquer la marche suivante. Je pénètre dans la Grande Salle. Nous n'y habitons pas, elle est trop vaste et couvre l'ensemble des sous-sols. Grand-Père en a fait une fruiterie. Il a installé des plans inclinés qui courent le long des murs. Là-dessus, bien alignées, des clayettes. Les fruits du jardin s'y reposent en attendant de disparaître au fur et à mesure que les mois passent. En ce moment les clayettes sont pratiquement vides excepté quelques vieilles pommes ridées de l'an passé et dont personnes ne veut plus : nous en sommes saturés car nous en mangeons toute l'année. Sur la grande table, au centre de la pièce, les bouquets de tilleul, avec leurs deux feuilles et leurs petites chouquettes arrondies attendent sagement nos futures grippes. Ma Tante Zabeth en met une grosse poignée dans le bain de son bébé et en fait des shampooings à Nicole sa blondinette. Dans un coin des sachets de papier contiennent déjà les bouquets de tilleuls prêts à l'emploi. La Grande Salle est lumineuse malgré les volets mi-clos. Je me précipite sur la porte à double battants en raflant au passage un des multiples chapeaux de paille pendus là, près de la sortie. Éblouie, je parcours la passerelle dominant le saut de loup. Aujourd'hui le ciment de la passerelle me brûle à travers mes sandalettes et les deux rambardes en fer forgé vert-foncé sont intouchables. Contrairement à mes habitudes, je ne m'attarde donc pas. J'atterris sur le terre-plein. Cette terrasse, bordée sur sa gauche d'un muret, surplombe la rue de six ou sept mètres. Sur sa droite un haut mur de pierres maintient la terre du jardin. Je grimpe l'escalier encaissé de deux remparts et je m'éloigne dans le jardin en pente forte pour m'évader vers le verger, au sommet de la colline. A cette époque de l'année, nous mangeons des fruits frais : fraises au goût sauvage, cerises juteuses ou griottes acides, abricots moelleux, poires fondantes, prunes reine-claude jaune-doré ou quetsches violettes. J'avale goulûment des quantités de prunes et je trouve bizarre cette sensation de gargouillis dans mon estomac. Je n'ai que le temps de me cacher derrière un arbre, prise d'une énorme colique. Chaque jour, je fais un tour pour m'assurer des progrès des poires en espalier. Interdit de toucher, cela fait des marques brunes sur les fruits. Une caresse avec la main bien à plat et je constate que celle-là est bonne à prendre. A quatre pattes dans l'allée, je fais des comparaisons entre les fraises et décide que la meilleure façon de comparer c'est d'y goûter. J'ai beau faire attention, il y a toujours une tache révélatrice de mes petits larcins sur mes vêtements. Le raisin viendra plus tard ainsi que les pommes, mais ni les uns ni les autres ne m'attirent. Tiens, voilà Grand-Père, portant un lourd panier d'orties destiné aux canards. D'ordinaire c'est Grand'Mère qui fait cette corvée, mais par cette chaleur il est allé loin dans les bois, dans les ornières. - Grand-Père, s'il te plaît, emmène-moi dans le Petit Bois ! - Bon, allons ! Un mur taillé dans de grosses pierres prolonge le côté droit de la maison et va se perdre loin dans la forêt. Une solide porte pratiquée dans le mur et munie d'une énorme serrure, donne accès au Petit Bois. Et là, là, c'est le Paradis. Ici, règne la fraîcheur. La source, jamais tarie, laisse suinter un filet d'eau claire. En été, l'endroit semble un peu désert. Il faut y venir à Pâques. Au printemps, le Petit Bois est enchanteur. Des violettes foncées et délicieusement odorantes m'attirent. Des coucous aux fines tiges vert tendre présentent leurs délicates têtes jaune-paille. De fragiles fleurs blanches en grappes s'agitent à la moindre brise. Les écureuils, à peine farouches sautent de branche en branche sans que ma présence ne les trouble. Les oiseaux, fous de joie pépient et se régalent sans s'éloigner de ce lieu magique... Le Petit Bois ? Un décor de contes de fées, plus idéal que ceux de mes livres d'images. J'entre de plain-pied dans l'irréel. La main rassurante de mon Grand -Père Arthur m'y introduit et me lâche dans la nature. J'ai un peu peur car les serpents rôdent, mais ce ne sont que d'inoffensives couleuvres. Je joue à avoir peur, un mélange de Cendrillon, de Peau d'Ane et de La Petite Sirène réunies. Toutes sortes de petites bestioles courent sur la mousse et se cachent dans les herbes. Je les observe et ils deviennent vite des monstres assoiffés de sang. C'est très amusant d'avoir presque peur quand tu sais que ton Prince Charmant, je veux dire Grand-Père, n'est pas très loin. Au moindre appel, il abandonnera son cher jardin et viendra me sauver, c'est sûr. Les mares et les fondrières se dessèchent, craquellent et je n'aperçois ni crapauds ni grenouilles comme à l'accoutumé. Pas de pauvres princes sur lesquels la méchante sorcière a jeté un sort, moi qui voulais leur parler... Je m'assois sur la mousse et je rêvasse que je suis une princesse bonne et douce. Assise sur un vaste trône en plein-air, je distribue des pièces d'or à tous mes sujets. Je reconnais notre boulangère de Jouarre, femme aisée qui possède certainement plus d'argent que je n'en aurai jamais. J'aperçois aussi dans la foule des quémandeurs, la marchande d'œufs et fromages, le facteur et le cantonnier. Arrive enfin le seul vrai pauvre, celui qui dans la réalité est le mendiant attitré du porche de l'église. Lui seul a droit à deux grosses poignées de pièces qui passent de mes mains propres et blanches à ses mains calleuses et douteuses. - Claudette, Claudette, où es-tu ? La voix de Grand-père me ramène à la réalité. Combien de temps ai-je été une princesse ? Assez longtemps en tout cas pour que Grand-Père s'inquiète et vienne me retrouver. Je me relève, me secoue et crie : - Au pied du gros arbre, Pépé ! - Arrive, ta tante te cherche pour la toilette. Me voici de retour au vingtième siècle. Ah ! la toilette vue par ma tante ressemble à s'y méprendre à un cauchemar ! En plein mois d'août elle estime que la meilleure solution pour ne pas salir la maison, c'est de nous réunir tous les quatre autour du puits. Situé à mi-parcours entre le mur de la terrasse et le fond du jardin, ce joli puits rustique est idéal pour arroser le jardin. Même pendant les vacances, ce sacré puits contient de l'eau ! Ma tante commence par Pierrette l'aînée de ses filles : aucun problème. Nicole, la seconde adore cette eau froide et en redemande. Dédé se laisse faire sans broncher. Ces trois-là, bien récurés de la tête aux pieds vont se faire sécher une serviette sur les épaules pour ne pas griller. Ma tante me garde pour la fin, connaissant mon aversion pour cette toilette de sauvage. Elle m'astique, comme elle astique les meubles, avec frénésie. Faut que ça brille ! Puis vient le shampooing. Première étape, une grande casserole d'eau froide sur la tête. Je hurle, je me débats, je lui échappe, mais elle a vite fait de me rattraper par un "abattis ". Elle est vive et rapide malgré son embonpoint de future maman. Elle me savonne la tête avec vigueur et casserolée après casserolée elle me rince malgré mes "beuglements" à ameuter toutes les villas environnantes ! Je la hais ! Chez mes Parents, le lavage de tête est un cérémonial aussi amusant qu'immuable. En été, dès le matin, un grand baquet se réchauffe aux rayons de soleil. Nous nous glissons dans le bain. L'eau pour le shampooing provient de la cuisine. Elle est tiède et Maman prend grand soin de ne jamais nous brûler. Elle nous tend une glace, met beaucoup de savon sur nos cheveux et nous fait des cornes bien droites sur le dessus du crâne. Nous nous contemplons, ainsi transformés en diablotins, et cela nous amuse follement. Ensuite, la tête bien en arrière, un gant de toilette sur les yeux, le rinçage s'effectue sans problème... Et je suis aussi bien lavée, sinon mieux qu'avec cette eau glaciale. A part cette maudite toilette, les vacances se passent merveilleusement bien. Ah ! si ! L'autre matin nous étions en train de prendre le café au lait dans la cuisine, quand soudain nous entendons Grand'Mère hurler. Sa voix provient du sous-sol. Quand nous faisons des âneries, elle crie, mais pas de cette façon. Pépé effrayé dit "un voleur" et fonce dans l'escalier au secours de sa femme. Grand-Père se met aussi à hurler. Nous descendons tous. Sur le ciment de la petite pièce Mémé étale nos lapins russes, tous morts. Empoisonnés, mais par quoi ? dit-elle. Nos lapins, Pépé les regarde attentivement. Ils portent à la gorge des marques de dents. -"Saignés à blanc, la belette" murmure-t-il. Grand'Mère dit : "Je vais faire des conserves, des pâtés." "Non, portons-les au fumier, je les brûlerai cette après-midi. Dieu sait ce que cette belette transporte comme germes. Les lapins peuvent être contaminés." On n'a jamais su par où elle était passée cette belette, elle a dû se laisser tomber du soupirail, les cages n'ont pas été forcées. On n'a jamais su non plus par où elle s'en est allée. Pépé a tout retourné, des casiers à bouteilles aux tas de bois en passant par la collection de bottes en caoutchouc et de sabots de toutes tailles. Rien, il n'a rien trouvé, même pas une trace. Mémé a vidé la paille des cages, les restants de nourriture et a porté le tout sur le feu au fond du jardin. Elle a nettoyé les cages à grand renfort d'eau de Javel. Plus de lapins, plus de délicieux civets ! Huit jours plus tard, un gros orage nous tient à la maison. Nous nous cantonnons dans La Grande Salle. Nous sommes très sages. Les trois femmes veulent écouter une pièce à la Radio. Mémé fait d'abord "chauffer" les lampes de la T.S.F. Le son arrive seulement après. Dans le placard il y a une réserve de ces grosses ampoules un peu tordues avec des picots en dessous, spécialement fabriquées pour les Radios. L'orage menaçant, juste au-dessus de nous, Pépé éteint la Radio. Les trois femmes ne sauront jamais la suite de leur histoire. L'orage gronde, les roulements du tonnerre nous apeurent, les éclairs qui se succèdent sans discontinuer, nous terrifient. Nous mourons de soif. "Je file au puits chercher de l'eau fraîche'" dit Pépé. Il prend une bouteille en verre, vert foncé, la tâte, trouve que son contenu est trop chaud, attend une accalmie et fonce tête baissée vers la passerelle tout en secouant sa bouteille pour qu'elle se vide plus vite. Une exquise odeur parfumée s'exhale de la passerelle ainsi baptisée. Pépé vient de vider les trois quarts de la bouteille de gnôle. Dommage, à l'occasion de certaines fêtes, j'aime bien lécher un petit sucre trempé dans le verre des grandes personnes. Cette gnôle est une fabrication familiale. Joseph, le frère aîné de Pépé perpétue la tradition. Leur père était bouilleur de crue à Saint-Aignan-sur-Cher, et c'est Joseph qui a hérité de la charge. Bon ! on ira en rechercher, de la gnôle. En attendant, nous mourons toujours de soif. Pépé repart à l'assaut du puits avec, cette fois, une bouteille en verre blanc totalement vide. Cet incident fut raconté des dizaines de fois, sauf à Joseph, le radin, qui aurait sûrement refusé de vendre un si bon produit du terroir à un frère aussi tête en l'air. A quelque temps de là, Grand'Mère décide de vider ses armoires et emmène dans la chambre du haut tous ses petits-enfants. En fait, elle ne sort pas le linge comme au Printemps, non, elle sort des boîtes et des boîtes de derrière les piles de draps. Elle a décidé de faire du vide dans le courrier qui s'est accumulé là depuis des années. Elle nous assoit sur le grand lit en fer, celui qui a des boules sur ses barreaux, relie certaines lettres, les froisse, les jette dans la cheminée. Elle nous montre de drôles de cartes postales, mal recoloriées de rose et de bleu délavés. Des cartes avec de la dentelle passent de main en main. Des photos de soldats avec des culottes rouges nous font rire aux éclats. "Mémé, c'est une farce, personne ne met des culottes rouges" dit la raisonnable Pierrette. " plutôt une méchante farce" explique Mémé. "Les soldats se faisaient tuer plus facilement à cause de cette culotte que les lapins dans les garennes à l'ouverture de la chasse." Nous ne comprenons pas tout, mais nous retenons qu'il est dangereux de porter une culotte rouge. Mémé continue de sortir ses coffrets bourrés de souvenirs et d'entasser des feuilles froissées dans la cheminée. Elle pense sûrement à tous ces gens qu'elle a connus et qu'elle ne voit plus. Elle se redresse et dit "Ce soir je descendrai ce tas dans le panier à bois, c'est l'heure de préparer le repas de midi. Nous dévalons les escaliers en criant comme des fous : nous avons été trop sages trop longtemps. La journée se passe sans incident. Au coucher, nous faisons un peu "la foire" en nous battant avec les oreillers de plumes. Plusieurs rappels à l'ordre sont nécessaires pour rétablir le calme. La cheminée en face du pied de lit est joliment décorée de papier fleuri. Sur le côté droit, une mignonne petite porte retenue par un crochet. Il est dix heures du soir, il fait grand jour et nous n'avons pas sommeil. " Et si on brûlait ce tas ? Comme ça Mémé n'aurait pas à le descendre ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Une chaise, une main, la boîte d'allumettes rigoureusement interdite, passe du rebord de la cheminée au foyer. Il faut plusieurs allumettes avant que la première flamme ne se décide à se montrer. Nous avons ouvert la petite porte comme nous l'avons vu faire "pour bien démarrer le tirage". Et ça flambe, et ça ronfle. Une chaleur intense se dégage dans la pièce. De hautes flammes nous empêchent de refermer la petite porte. Nous ne nous décidons toujours pas à appeler. Chaque soir Grand-Père prend le frais en fumant une dernière cigarette. Il se promène tranquillement sur la terrasse, fait demi-tour et rentre dans la Grande Salle après quoi il verrouille toutes les portes. Ce soir, en faisant demi-tour, il aperçoit de hautes flammes qui sortent de la cheminée. Il pousse un juron "Bon sang y'a le feu. Caroline, Denise, Zabeth, y'a le feu chez les gosses." hurle-t-il à pleins poumons. Quatre à quatre les femmes nous sortent, prennent des seaux d'eau, les cruches pour la toilette du matin, vident avec ardeur de grandes quantités d'eau mais le feu ne cède pas. Le tuyau d'arrosage n'est d'aucun secours ; l'eau ne peut monter si haut. Pépé arrive du jardin avec de grands seaux remplis de terre. A la longue, le feu dans la cheminée meurt étouffé, mais pas celui des conduits qui continue inlassablement à ronfler. Rien à faire, dit Grand-Père, ce sont la suie et les goudrons qui brûlent. Il ajoute mi-inquiet, mi-rassurant : On devait faire ramoner à la fin du mois, je crois bien que c'est fait". Vous pouvez me croire nous n'avons même pas reçu de raclée. Ce soir, Pépé et Mémé règlent leurs comptes. Ils ont beau parler à voix basses, j'entends tout à travers la cloison. Pépé dit : Laisser du papier et des allumettes à portée des gamins, c'est tenter le diable. Mémé attaque : Avec ta négligence proverbiale, y'aurait pas eu le feu si tu m'avais écoutée. Tu devais t'en occuper au printemps. Le 15 Août est passé et toujours pas de ramoneur. La conversation dure longtemps, mais nous finissons par nous endormir avant de savoir la fin, tout danger écarté, dans une odeur épouvantable, la fenêtre grande ouverte, sous la clarté d'une belle nuit d'été. La Maison ! Nous l'avons revue il y a peu de temps. Nous avons arrêté la voiture de l'autre côté de la chaussée et nous sommes restés là plantés comme des imbéciles à la regarder. Notre présence insolite a effarouché un gentil petit garçon perché à six ou sept mètres au-dessus de nos têtes. L'enfant a appelé son grand-père. L'homme soupçonneux nous a interpellés. "Nous regardons la maison" ai-je répondu. Nous nous sommes engouffrés dans la voiture, Dédé, sa femme, mon mari et moi, sans oser dire à cet homme notre ardent désir de rentrer, de revoir le sous-sol, la Grande Pièce, les chambres, la terrasse, le jardin, le puits, le Petit Bois. Nous nous sommes enfuis avec nos souvenirs et une immense tristesse au fond du cœur . Montpellier, le 8 décembre 1995 |
| Claudette Prévot |