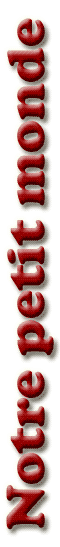![]()
 |
||
| Portraits | ||
|
||
Caroline |
||
|
Une vapeur humide s'élève du sous-bois. Les sapins laissent à peine pénétrer la lumière matinale d'automne. Le Morvan se secoue des pluies incessantes de la semaine passée. François Foucher enfile ses meilleurs sabots et se hâte. Il presse le pas car il va chercher la sage-femme. Cela fait des heures que Catherine, son épouse, gémit et que le bébé n'arrive pas. François se dit que ce n'est pas normal et il craint un grand malheur. Elle n'est plus toute jeune sa Catherine, bientôt trente-neuf ans... Comme le temps passe ! Elle est superbe, de grands yeux noirs, durs et volontaires. Sa chevelure très brune, abondante et ondulée lui descend jusqu'aux reins quand elle daigne retirer son bonnet blanc. " Mais quel foutu caractère ! " murmure François en hâtant de nouveau le pas. La venue des deux aînés n'a posé aucun problème. Philibert va sur ses quatorze ans : il est grand, beau, plein de prestance et les filles du village le regardent passer. Marie a onze ans ; c'est une belle fille, coquette et autoritaire. " Pourvu que j'arrive à temps ! " se dit François qui se met à courir. En le voyant arriver tout essoufflé, la sage-femme comprend mais ne se presse pas. " Tous pareils ces futurs pères, et celui là c'est son troisième enfant ; bon sang, il devrait être habitué ! " Elle repousse son chaudron sur le côté de la cheminée pour que la soupe reste chaude en son absence. François s'énerve ; mais elle prend le temps de s'emballer chaudement dans un vaste fichu avant de tirer la porte derrière elle. En approchant de la maison, François et la sage-femme entendent Catherine hurler malgré l'épaisseur des murs de cette robuste maison de montagne. Décidément ce bébé tarde à venir. L'accouchement sera interminable. Quand enfin la sage-femme remettra à Catherine épuisée une minuscule petite fille violette et chiffonnée, celle-ci se détournera, méprisante. Elle utilisera toute son énergie pour crier : " Et c'est pour ça que j'ai tant souffert ! et moi qui espérais un garçon ! " Ainsi venait de naître une petite Caroline, adorée par son père dès l'instant où il fut autorisé à la tenir et détestée par sa mère qui projeta tout son amour sur Marie la grande sœur. C'était le deux septembre 1889. Ma Grand'Mère Caroline Foucher faisait une entrée très remarquée au village. La petite Caroline grandit et très jeune fut chargée de nombreuses corvées. François, le sabotier, gagnait bien sa vie. Il produisait non seulement le sabot courant mais il présentait souvent au concours du canton, des sabots plus raffinés, artistement décorés de cuir. Il gagna le prix du chef-lieu en apportant une nouveauté considérable : des sabots pour enfants, solides certes, mais plus légers qu'à l'ordinaire. La bordure de cuir souple était ornée de fleurs des champs que même la neige n'arrivait pas à ternir. Solides les sabots de Papa François, bien sûr, mais cela dépend de l'usage que l'on en fait. Agée de cinq ans Caroline se rend à l'école située à cinq kilomètres du village. Pour sa première année, ses parents la confient aux grands qui l'emmènent et la ramènent. Un jour, Caroline, la teigneuse petite Caroline, décide que personne ne doit la dépasser sur le chemin du retour. Elle n'a peur de rien. Sa taille en dessous de la moyenne ne la gêne pas dans ses actes. Les grands garçons se moquent d'elle. Elle n'hésite pas une seconde. Attrapant ses sabots d'une main et courant à vive allure sur ses gros bas de laine, elle tape de toutes ses forces sur les garçons. Ceux-ci se protègent comme ils peuvent. A plusieurs reprises les sabots rencontrent les gamelles contenant les vestiges du repas de midi. Caroline gagne la première manche. Elle perd la seconde. A l'entrée du village elle se rechausse et s'aperçoit avec horreur que ses sabots sont tellement fendus qu'il est difficile de marcher avec. Elle reçoit une sacrée volée de coups de triques et s'en souvient toute sa vie ! Catherine est une maîtresse femme. Et ça tourne rond dans cette vaste pièce. A peine levée Catherine se précipite vers la cheminée, réanime le feu, et met la soupe à réchauffer. Elle donne la première tétée à l'un des multiples petits que l'Assistance Publique lui confie. Peu d'orphelin, car un orphelin a toujours une famille, un oncle, une cousine même éloignée, une grand'mère, qui recueillera l'enfant, surtout si c'est un garçon. C'est un bon calcul, car dans peu de temps ce gosse sans parents travaillera pour vous. En cette fin de siècle, contrairement à la légende, ce n'est pas La Belle Epoque, c'est le plein épanouissement de l'industrie. Une classe sociale très pauvre et très courageuse travaille sans relâche dans ces usines florissantes. Il ne s'agit pas pour une jeune femme de perdre son travail. Si elle gagne assez, elle placera l'enfant en nourrice, sinon, elle l'abandonnera à l'Assistance. Les enfants de l'Assistance sont légions. Ce sont souvent des gosses des villes que l'on expédie dans les campagnes les plus reculées. Ils arrivent jusqu'ici, en plein cœur du Morvan, dans une montagne coupée du monde extérieur où les communications sont difficiles parfois même inexistantes en hiver. Catherine est nourrice agréée par l'Assistance Publique. Elle gagne une misère à faire ce travail qui ne lui laisse aucun répit. L'Administration est avare de ses deniers... Catherine reçoit donc chaque année de jeunes nourrissons qu'elle allaite, lave, change, soigne, berce d'un pied dans un lit à bascule, tandis qu'elle épluche des légumes. Elle ne perd pas une seule minute. Et les contrôles tatillons et fréquents ne pourront jamais rien reprocher à la nourrice attentive. Un jour, un contrôleur a atterri au village. Il a fait sensation. Cet homme des villes, en chaussures de cuir, chemise à col et chapeau, s'est embourbé devant l'unique porte d'entrée. Il a regardé attentivement les nourrissons. Puis il a contemplé Catherine allaitant le petit Michel, le dernier venu. Cet homme a déclaré à Catherine interdite qu'elle le nourrissait trop. Elle a regardé cet élégant individu de toute la force de son regard noir de colère. Elle a reposé l'enfant, puis elle s'est prestement réajustée. Elle lui a hurlé en le repoussant avec violence vers l'extérieur " Et si c'était le vôtre, ça s'rait trop ? " Le représentant de l'Assistance Publique glissa et s'affala de tout son long sur le talus couvert de paille détrempée de pluie. Catherine pensa immédiatement qu'elle venait de perdre son activité mais elle ne sortit pas aider cet ignoble individu. Cet incident hors du commun fit rapidement le tour du village. Et durant tout l'hiver, pendant la veillée, Catherine dût raconter et encore raconter comment elle avait chassé de chez elle un monsieur très important. Ils étaient fiers, les villageois, qu'une femme illettrée ait osé tenir tête à un homme de la ville. Il n'y eut pas de conséquences ; peut-être l'homme en question ne se vanta-t-il pas de l'incident ? Au printemps suivant apparut au village une femme d'âge incertain, sobrement vêtue, qui venait contempler le bon travail accompli par Catherine. Elle emmena Joseph, le joli petit roux aux yeux verts, qui avait maintenant six ans. Ce fut un déchirement pour tous. Joseph hurla " Maman Catherine garde-moi, je n'ai rien fait de mal, garde-moi ! " Catherine lui dit qu'elle attendait déjà son retour. L'assistante l'emmena de force. Encore un petit frère qui venait de partir ! Il revint voir ses " Parents " et à l'âge adulte vint présenter sa fiancée à sa seule famille. Le travail causé par la présence de nourrissons n'est qu'une des multiples occupations de Catherine. Celle-ci, en bonne maîtresse de maison, s'occupe de tout. Par exemple, deux fois par mois, Catherine se lève avant le jour. Elle ouvre la maie, sort le reliquat de levain précieusement conservé, tire jusqu'à elle un lourd sac de farine suspendu à la poutre pour que les souris des champs ne viennent pas voler cette précieuse denrée. Ce matin Catherine prépare la pâte à pain. Tandis que les grosses miches de pain gris lèvent et gonflent sous le vaste édredon en plumes d'oie, Catherine fait la vaisselle. Elle a de la chance, et les voisines sont jalouses de la belle pierre à évier que son François lui a posée. Elle peut faire sa vaisselle debout et jeter son eau sale dans le trou spécialement aménagé. Quel progrès ! Plus besoin d'être accroupie devant la cheminée pour laver les assiettes et surtout plus besoin de laisser échapper la chaleur en ouvrant grande la porte pour jeter l'eau sale à l'extérieur. Catherine s'active et fait diligence. Un bébé pleure, le pain est prêt à cuire. Elle commence par le pain, bien levé, et qu'il faut mettre à cuire sans tarder. La cheminée n'est pas trop chaude, juste à point, le pain sera parfait. Elle tire une chaise devant la cheminée, saisit l'enfant affamé, s'assoit, sort un sein généreux. Tandis que l'enfant s'étouffe de plaisir tant il boit goulûment, Catherine surveille attentivement la cuisson des miches de pain. Elle cale le bébé entre deux gros oreillers de plumes pour qu'il fasse son rôt, puis retourne vers le pain. Elle démaillote ensuite le petit, trempé et souillé, par une longue nuit de sommeil. Elle le lave puis le change. Les couches sont de grands rectangles de coton. Ce sont d'anciens draps très solides mais qui ont fait leur temps. L'usure au centre est si totale qu'il a suffi de tirer un peu pour en faire des morceaux. Elle met les linges malodorants dans un grand seau d'eau glacée. Ensuite, elle ne s'en occupera plus. A cinq ans, par tous les temps, la petite Caroline va donc à l'école. Dix bons kilomètres aller-retour. Elle aime l'école et malgré son jeune âge apprend très vite. Heureusement pour elle, car malgré les supplications de François, Catherine a exigé que, dès la deuxième année, Caroline revienne après le repas de midi. C'est un déchirement pour la jeune enfant de laisser ses camarades s'ébattre après le repas. Comme ils ont de la chance, pense-t-elle. Elle contemple avec émotion la belle carte de géographie et les tableaux d'histoire dont, cet après-midi, elle n'entendra pas le commentaire. Un sentiment d'aigreur et de révolte envahit ce jeune cœur d'enfant. Tandis que ses camarades seront tranquillement assis ou feront sournoisement des bêtises pour " embêter " ce maître d'école si méchant, elle fera des corvées bien au-dessus de son âge. Elle voudrait bien ne pas rentrer. Parfois elle cueille un beau bouquet de fleurs des bois ; mais ce bouquet est la preuve formelle qu'elle ne s'est pas pressée de rentrer. Alors tristement elle le jette dans le ruisseau. Elle le suit du regard. Le bouquet se faufile entre les roches. Il glisse, s'éloigne en zigzaguant, puis disparaît de sa vue dans le coude du ruisseau. Elle flâne encore un peu, pas trop cependant, car de toute façon, elle n'évitera pas ses repoussantes besognes. C'est elle qui lave les couches des nourrissons de sa mère. A peine arrivée à la maison, elle se fait houspiller et sa mère d'un mouvement de menton lui désigne les seaux pleins de linges nauséabonds. Au village, comme dans tout le Morvan, l'eau source partout. Chacun a son puits, sa fontaine, son ruisselet sortant à ras de terre. Mais on lave dans l'Yonne, dont l'eau rapide, pure et glacée donne au linge une luminosité et une odeur incomparables. Caroline soulève à grand-peine les deux énormes seaux, si hauts, si vastes, qu'elle doit tenir ses bras écartés de son corps, comme Jésus sur la croix, pour qu'ils ne traînent pas sur le chemin. Elle a essayé plusieurs méthodes. La première consiste à sortir de la maison avec les deux seaux. Une fois hors de vue, elle en abandonne un, au détour du sentier. Ensuite elle revient le chercher. Elle a essayé de transporter le linge à bout de bras dans une vieille taie d'oreiller. Mais dans tous les cas, elle est obligée de refaire un trajet malaisé, long et escarpé. En effet, les seaux sont indispensables. Après le lavage, nulle place possible sur les gravillons de la berge pour déposer le linge propre. Ce chemin qui mène de la maison au torrent est un raidillon encaissé, creusé par les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, Caroline est fatiguée. Les seaux lui semblent plus pesants qu'à l'ordinaire. Et comme toujours, ils lui cachent la sente. Caroline bute dans un caillou, perd un sabot, s'affale de tout son long dans les couches maculées de déjections. Fort heureusement, ses nombreux cotillons amortissent la chute. Un court instant, elle s'assoit, découragée ; puis, d'un geste énergique et rageur, elle se redresse, tire à elle son sabot, ramasse toutes ces saletés éparpillées. Son petit visage fermé et buté reflète une immense vague de colère. Elle ne pleure pas. A cette heure là, seule dans la nature déserte, elle crie et jure que jamais elle n'aura de marmots, de ces choses répugnantes, braillardes, vomissantes, qui expulsent de leurs corps si petits, des tonnes d'ordures. Caroline dans la sagesse de ses sept ans ne voit que cette immonde corvée... Caroline ne tiendra pas sa promesse... puisque nous sommes tous là, nous ses descendants ! Soixante-six ans plus tard, à la maison, nous avons une des premières machines à laver, peu performante et avec laquelle il faut encore pas mal de manipulations. Caroline regarde cet objet incongru avec mépris. Dans le jardin, vous pouvez alors contempler une petite Caroline âgée de soixante-treize ans. Elle a installé sur une caisse au soleil un grand baquet d'eau bouillante, une planche à laver et une brosse. Et vous ne devinerez sûrement pas ce qu'elle fait la têtue de petite Caroline. Reniant toutes ses promesses enfantines, elle lave des couches, oui vous avez bien entendu, des couches. Fière, ne laissant ce soin à personne, Caroline lave les couches de son arrière petit-fils Dominique. Et elle le gâtera, et elle le pourrira, et rien ne sera trop beau pour cet enfant paré de toutes les qualités... Mais en attendant d'être une arrière grand'mère tendre et dévouée, la jeune Caroline, sale, trempée, descend le raidillon et arrive enfin à l'endroit où le torrent fait un coude et où il a déposé des graviers. Elle se dirige droit vers la caisse en bois familiale. Là, elle s'agenouille, verse de la cendre sur le linge, frotte pièce par pièce, de toutes ses forces et rince une première fois. Le battoir entre alors en action. Elle rincera jusqu'à ce que l'eau soit parfaitement claire. Remonter la pente raide, ainsi chargée, demande de l'entraînement. Après de nombreuses pauses, Caroline voit enfin apparaître la route et les premières maisons du village. Elle pose ses seaux sur le bord de la route et observe son village. Ces toits de chaume apportent à l'enfant un peu de chaleur. Elle aime ces toitures, confortables l'hiver et fraîches l'été. Elle aime le jour où les voisins viennent donner un bon coup de main pour découvrir totalement le toit, et pour le couvrir le plus vite possible avec adresse et précision. Une bonne toiture, c'est la vie ! Et quand le bouquet est enfin accroché sur le faîte du toit près de la cheminée, les réjouissances, repas copieux, boissons abondantes, chants et musiques peuvent enfin se déployer. Caroline cesse de rêvasser, rattrape ses seaux et se dirige vers la maison. Pour toute récompense, Catherine grogne : " Tu en as mis du temps ! " Caroline ne répond pas. Instruite par l'expérience, elle sait que même répondre poliment, c'est s'exposer à une sévère raclée. Elle plante les seaux devant sa mère et s'éclipse vers l'atelier de son père. François s'est aménagé un atelier de sabotier, calme et spacieux. Situé derrière la maison, l'atelier est jointif à la grange et au bûcher. Une cheminée de pierre permet à François d'y séjourner du printemps à la fin de l'automne. C'est son domaine et nul, pas même sa femme, n'est autorisé à y pénétrer. Par contre, sous prétexte de lui apprendre à lire, François a décidé que Caroline, ses corvées terminées, devait l'y rejoindre. Un grand élan de tendresse précipite Caroline vers son père. Puis François étonné éloigne sa fille de lui et la contemple. Les vêtements de l'enfant s'égouttent tant ils sont trempés. François pique une énorme colère contre sa femme et s'apprête à entraîner sa fille vers la maison pour qu'elle se change. Caroline supplie son père de n'en rien faire car elle court vers une bonne volée assurée. François ne dit rien. Sur un lit de copeaux, il entrecroise des branchettes. Un bon feu réchauffe rapidement l'atmosphère. Il met quelques bûches plus grosses, installe un banc devant la cheminée, sort sa blague à tabac et sa pipe. Caroline retire ses sabots inondés et les met à bonne distance de la cheminée pour qu'ils sèchent lentement sans se fendre. Caroline s'assoit à côté de son père. Peu à peu ses vêtements et ses bas exhalent leur trop-plein d'eau et fument. De quoi attraper la crève, marmonne François en serrant ses dents avec rage sur le tuyau de pipe. La leçon de lecture peut enfin commencer. Le seul livre existant chez les Foucher est un vieux missel. Mais François, plutôt anticlérical ne va pas apprendre à lire à sa fille dans un livre en latin. C'est bon pour le curé ces machins-là ! pense-t-il. Le Français est la langue officielle de la République. Alors le père consciencieux déplie son journal, " Le courrier de Château-Chinon ", et la leçon commence. Pendant plusieurs mois ils se contentent des lettres formant les gros titres et les sous-titres. Puis Caroline reconnaît par cœur ces mêmes titres sans savoir lire réellement. François s'en rend compte et tourne la page. C'est la revue nécrologique de l'arrondissement qui permet à Caroline de fignoler son apprentissage. Chaque matin à l'école elle emmagasine avec joie toutes les connaissances proposées. Elle ne prend pas le temps de chahuter comme la majorité de ses camarades. C'est une bonne élève. Elle expose à son père attentif le contenu des leçons quotidiennes. Et pourtant le maître d'école est un drôle de personnage. C'est un gros homme, à la tenue négligée, qui sent l'alcool dès onze heures et surtout qui se montre d'une extrême violence vis-à-vis des enfants. Cette après-midi Caroline rentre à la maison les mains et les mollets zébrés de vilaines traces bleues, des traces si profondes que par endroits la peau est fendue. Elle prétend être tombée. Ses parents supposent sans hésiter un seul instant qu'elle s'est battue comme un garçon, et pour la punir lui administrent une raclée mémorable. A la question : " Avec qui t'es-tu battue ? " Caroline répond sans réfléchir : " Avec l'Eugène." Eugène a douze ans, il est grand, fort et paraît plus que son âge. Caroline a sept ans et n'en paraît pas cinq. François ne dit rien, enfile sa grosse veste de drap, sa casquette et tirant Caroline par un bras dit à sa femme : " Je vais lui en toucher deux mots, moi, à l'Eugène ". Caroline supplie mais le père est intraitable. Il traîne Caroline qui refuse d'avancer. Elle crie " Papa, ce n'est pas lui, c'est le maître d'école. " De saisissement François s'arrête. Le maître d'école ! répète-t-il. Ca ne fait rien, conclut-il, Eugène nous expliquera cela. Eugène raconte que ce matin le maître était totalement ivre dès la rentrée. Il se promenait de long en large tenant le tisonnier servant à soulever le couvercle du gros poêle de fonte. Il a tapé sur Caroline simplement parce qu'elle est assise au premier rang sous son nez, et que selon lui elle répondait trop lentement. Les grands élèves, dont Eugène, sont intervenus. François, ému, sert avec force la main de l'élève courageux. Le lendemain François attelle la voiture et emmène Caroline et Eugène à l'école. Il se contient pendant les cinq kilomètres. Mais à peine arrivé, il saute à terre et se jette sur le maître d'école en le tenant solidement par les revers de sa veste. Il pénètre dans la classe, prend le tisonnier et dit : " Vous voulez en tâter de celui-là ? Ne touchez à aucun de vos élèves, sinon, aussi sûr que je m'appelle François Foucher, vous pourriez être infirme pour le restant de vos jours ". Le vieux maître ventripotent réussit cependant à apprendre à lire et à écrire en Français à toutes ces têtes dures de petits Morvandiaux agités qui parlent entre eux un rude patois. Ils apprennent aussi à compter dans les nouvelles unités. Les mesures agraires, les poids, comme le kilogramme, les volumes, doivent être les mêmes pour tous, sur le sol national. Il enseigne tout ce qu'il sait lui-même et les grands partent dans la vie aussi instruits que leur maître. En réalité il faudra plusieurs générations pour abandonner des pratiques de vie séculaires : Ces jeunes gens achèteront ou vendront des animaux, des terres, du bois dans les unités de mesures de leurs parents. Le maître d'école s'efforçant d'être sobre, reste donc en place. Comme le printemps a beaucoup de mal à s'installer cette année, les élèves se sentent un besoin énorme d'évasion. Le maître est toujours rude et peu agréable. Le soleil s'active pour faire fondre cette neige qui stagne encore dans les sous-bois. Peu à peu les sentiers deviennent praticables, l'eau glacée s'écoule vers les ruisseaux et une multitude de fleurs des champs et des bois embaument l'air. Les élèves fourmillent d'idées non scolaires et préparent en secret une vaste folie. Fin juin, les journées sont longues, et les terrains bien secs. Le maître sort sur le pas de la porte et consulte sa montre gousset. Personne n'est en avance aujourd'hui. On voit bien que les travaux des champs sont commencés. Après cette réflexion le maître rentre dans la classe et attend un peu. Il a prévu une belle leçon sur le cheval, sur son pied si bizarre. Cela va sûrement intéresser ces rustres pense-t-il. Il ressort, consulte de nouveau sa montre, l'écoute pour constater qu'elle fonctionne bien. Aucun enfant en vue. Il ne dit rien, rentre en classe, sombre et angoissé. Il se dit qu'une maladie grave, le charbon peut-être, s'est répandue d'une façon fulgurante sur les villages alentour, avec l'arrivée du printemps. Il s'enferme dans sa classe déserte et... attend. A onze heures, il rentre dans son logement, adjacent à la salle de classe, et mange sans appétit. A treize heures il réapparaît, triste et désespéré, sur le seuil de sa classe. Pas un élève, pas un parent n'est venu. Il s'enferme de nouveau, pris de panique à l'idée que ses petits monstres puissent périr comme les vaches. Il est sauvage, célibataire endurci, mais il découvre avec stupeur qu'il éprouve un certain attachement pour ces têtes de pioche montagnardes. Pendant ce temps, tous les enfants sans exception, s'ébattent dans le grand bois de sapins. Ils sont partis de chez eux comme à l'ordinaire, le repas dans la gamelle, en direction de l'école. Puis avec des détours et des ruses multiples, se sont retrouvés, joyeux, dans la grande clairière. Tous, tous, de l'enfant de cinq ans aux grands de douze ans, ont réussi à tenir leur langue, et n'ont pas flanché au dernier moment. Les petits Morvandiaux font l'école buissonnière. Une expérience extraordinaire, une totale liberté, sans autorité, sans parents, la vraie vie en somme. Ils jouent à tous les jeux qu'ils connaissent, mais se lassent et commencent à avoir faim. Ils s'installent en rond et avalent le contenu de leur gamelle, dévorent leurs tranches de pain, les oignons, le lard, et bientôt il ne reste rien. Fatigués, ils se reposent, puis reprennent leurs jeux sans le moindre entrain. En regardant le soleil à travers la cime des sapins, ils constatent que c'est l'heure de rentrer. Alors tristement ils reprennent le chemin du retour, un peu déçus à la fois que " la bleue " soit déjà terminée et qu'elle n'ait pas apporté plus de bonheur. Cette école buissonnière, préparée avec soin depuis plusieurs semaines, n'est pas à la hauteur des espoirs évanouis. Les enfants sortent tous ensemble du bois, et c'est là l'erreur. Le garde-champêtre les rencontre sur le chemin du retour. Il consulte sa montre et les interpelle. " Le maître vous a lâché bien tôt aujourd'hui ! " " Oui, répond l'Apollinaire, c'est la saison... " Il voudrait dire que les travaux des champs appellent la jeune main-d'œuvre, mais il n'achève pas son mensonge. En effet le garde champêtre constate que les tout-petits, ceux qui ne vont pas aux champs, sont là aussi. Il comprend que le maître a sorti la classe pour étudier les plantes. " Oui, oui ", répondent les enfants avec enthousiasme. Cela sonne si faux que l'homme réagit. Il comprend brusquement que le maître n'a jamais été présent. Il les ramène tous à l'école. Chemin faisant ils rencontrent des villageois. Le garde champêtre raconte sa trouvaille. Inutile de dire comment se passe le retour, ni comment les gamins sont accueillis par le maître. Les familles averties, n'hésitent pas. Elles donnent carte blanche au maître : on envoie nos enfants à l'école pour qu'ils en sachent plus que nous, pas pour qu'ils folâtrent dans les bois. Ce soir, dans les villages, on entend hurler les gamins sévèrement corrigés. Et la vie reprend son train-train habituel. Peu de fréquentation, à l'école, en ce beau mois de juin finissant. Les cours se terminent normalement après les fêtes du quatorze juillet mais seuls les inutiles, les petits et quelques filles dont Caroline, suivent les leçons du vieux maître assagi. Les fêtes de la Saint-Jean avec ses grands feux qui brûlent toute la nuit, les danses au son du bandoléon, ne sont déjà plus qu'un souvenir. Toute une main-d'œuvre gratuite, faucille à la main, s'active en effet sur les versants hérissés de roches. Il faut faire vite, toujours plus vite, on prête main-forte aux voisins. Une entraide séculaire s'organise spontanément non seulement entre gens d'un même village, mais aussi avec les parents et alliés des villages environnant. Les vieux qui n'ont plus personne auront tout de même de quoi nourrir leur unique vache ou leur maigre cheval. On ne laisse rien, on coupe l'herbe sur des pentes impressionnantes, dans des recoins impossibles. Dans les champs les adultes manient la faux avec dextérité. Il s'agit de couper les foins, de rentrer la paille et de mettre les précieux grains à l'abri en un temps record. Il s'agit aussi de ramasser les légumes et les fruits qui sont à point sans plus attendre. Les charrettes font de nombreux aller-retour. Dans la cour de la ferme, hommes et femmes en ligne battent les grains au fléau. Cela donne lieu à des concours, et si l'on travaille très dur, on rit beaucoup. Ici on ne peut pas dire " C'est l'été, les journées sont longues, nous avons le temps ". Car sans prévenir surviennent les grêlons aussi gros que des œufs de pigeon, les pluies qui transforment les chemins en torrents, les orages qui ravagent tout. Aujourd'hui le temps est lourd, la chaleur intense. Le village est écrasé par une moiteur lourde et pesante. Au loin on entend de sourds roulements, le ciel se charge rapidement de vastes nuages noirs en forme d'enclume. Les paysans ramassent précipitamment les râteaux et filent vers le village. Il est temps. L'orage violent est là, sinistre et angoissant. Une pluie diluvienne s'abat soudain sur les montagnes et la vallée encaissée de l'Yonne. Les grondements du tonnerre se répercutent d'un flanc à l'autre, dans un écho impressionnant. Malgré l'étroitesse des fenêtres, les éclairs fulgurants éblouissent les humains apeurés. Le buis bénit accroché juste au-dessus de la porte est là pour protéger ses occupants, certaines femmes prient et les chiens sont autorisés à côtoyer leurs maîtres. Car ici en montagne la foudre tombe et tue. Chaque année des arbres géants sont noircis et fendus jusqu'aux racines. Chaque année des animaux et des hommes sont fossilisés dans les positions où les forces de la nature les ont surpris. L'orage dans ce Morvan rude et sauvage n'est pas une plaisanterie. Et si par malheur les foins ne sont pas rentrés, ils n'arriveront jamais à sécher et pourriront. Sous un ciel serein, où le soleil brille avec vigueur, on aura beau les étaler, les retourner, ils pourriront tout de même. Pas de foin, pas d'animaux et une population qui a faim jusqu'à l'année suivante. Peu de gens ont de l'argent liquide qui permettrait d'acheter ailleurs ce qui a été saccagé au village. On a des biens, des terres, des bêtes. On se nourrit des légumes, des fruits, des poules et de leurs œufs, des lapins que l'on produit. Chaque famille élève son cochon et le tue à tour de rôle. Cela donne lieu à de grandes fêtes où l'on mange et où l'on boit plus que de coutume. Ce cochon devra faire l'année, jusqu'au moment où le suivant sera prêt à être consommé. Ce n'est pas tous les jours qu'on mange de la viande dans les chaumières ! Caroline approche des huit ans. Elle n'a pas un seul jouet, pas de poupée, pas de ballon, rien. François, adroit comme il est, n'a pas idée de lui confectionner une poupée articulée et pourtant il en est capable. Cet été elle a décidé de se promener seule. Elle marche longtemps, un peu de nourriture dans ses vastes poches. Elle s'enfonce dans la forêt, toujours plus loin, marche encore et tombe enfin sur ce qu'elle veut voir. Elle veut connaître des gens peu recommandables, des parias, des gens qu'on ne fréquente pas, qu'on méprise. Tous les vols, les crimes, les choses bizarres qui se passent dans les villages sont attribués aux charbonniers. Les charbonniers ce sont ces gens étranges qui vivent seuls une grande partie de l'année, qui ne parlent jamais. Ils apparaissent de temps à autre en quête de nourriture, et les paysans en profitent pour se faire payer grassement. Ce sont des sauvages, des êtres à part. Les villageois avec leurs tares multiples se croient parfaits. Ils ont leur fou, leur simplet, leur gâteux, leur fermier violent qui bat sa femme, l'ivrogne que l'on retrouve dans le caniveau. Mais voilà, ce sont des villageois ! Les autres membres de la petite communauté sont remplis d'indulgence pour leurs travers et ferment les yeux. Par contre, les Morvandiaux ne pardonnent pas aux charbonniers d'être indispensables pour la fabrication du charbon de bois, et d'avoir une renommée qui dépasse nos frontières. Les Morvandiaux trouvent tous les défauts à ces gens différents d'eux, et s'en écartent. Dire que les charbonniers sont sales et pas bavards est plutôt cocasse. Comme si dans les villages on était propre, bien lavé, jamais barbouillé, comme si on était causant, souriant et affable dans ces montagnes retirées. Caroline arrive enfin au cœur de la forêt. Elle n'a pas peur, et s'approche. Elle voit de grosses meules fumantes recouvertes de terre et d'herbe fraîche. Une grosse voix l'interpelle dans un patois âpre et saccadé. Cela la fait sursauter, mais elle n'a pas peur. Elle répond dans le même langage : " Je veux savoir comment tu fais le charbon ". L'homme n'en revient pas. Une gringalette seule perdue au milieu du bois qui n'a pas peur et qui veut parler à un exclu. Il lui dit : " Assieds-toi, t'as faim, tu veux un coup à boire ". Vraiment ce rejeton de gamine le surprend. Il n'a plus rien à dire. Elle fouille au fond de sa poche, sort son guignon de pain et mâche rapidement. L'homme rit de bon cœur. De toute sa vie, il n'a jamais vu un tel spectacle. Il se lève, ramène une petite marmite noircie de fumée. Il s'en retourne, revient avec une assiette en fer blanc et deux cuillères à soupe. Il tend à Caroline l'assiette pleine de bons gros haricots et y plante une cuillère. Il s'assoit tire la gamelle entre ses jambes et grogne " J'ai qu'une assiette, mange pendant que c'est chaud ". Il plonge son énorme couteau dans la gamelle, coupe et en ressort une solide tranche de lard qu'il fait glisser dans l'assiette de Caro interdite. Face à face, lui courbé, le nez dans la marmite, elle raide et droite pour avoir l'air plus grande, ils mangent sans se regarder, sans sourire, sans parler. Caroline ne veut rien laisser, mais elle en a beaucoup trop et ralentit. L'homme comprend et toujours sans aucune parole retire l'assiette à l'enfant repue. Caroline murmure " Merci Monsieur ". Alors là, il n'en peut plus, il s'étouffe de rire. Monsieur, lui, l'individu sur qui les paysans lâchent les chiens, elle est vraiment incroyable cette gosse. Incroyable et têtue comme la bourrique qui tire la charrette ce petit bout de femme. Caroline ne se décidera à partir qu'au moment où il lui aura enfin raconté son secret, ce secret qu'il ne livre à personne : la fabrication du charbon de bois. L'homme se sent fatigué d'avoir tant parlé. Soudain il regarde la direction du soleil et réalise que cette drôlesse va se faire prendre par la nuit. Il attelle la carriole et ramène à vive allure la petite effrontée jusqu'à l'orée du bois. Il fait demi-tour et disparaît sans dire au revoir. Caroline est à l'heure pour la soupe, mais elle n'a pas faim et tombe de fatigue. Ses cheveux et vêtements sentent la fumée mais elle dit qu'elle a fait un petit feu au bord de la rivière et s'endort épuisée. Des années plus tard, Caroline raconte à François sa visite au charbonnier. La réaction cinglante de son père la surprend : " Mais enfin Caro, tu n'as aucun sens de l'honneur, un homme qui t'a reçu, qui a partagé son repas avec toi, à qui tu as fait perdre son temps et que tu n'as même pas remercié correctement ". Sans réfléchir, sous l'impulsion de la honte des convenances non respectées, François attelle et conduit Caroline dans le grand bois. Ils aperçoivent un jeune homme hirsute et s'enquièrent du charbonnier. " Le vieux, y'a bien longtemps qu'il a cassé sa pipe ! " Et il leur tourne le dos. Le retour s'effectue dans un silence lourd de tristesse. Caroline a de la peine, mais elle se révolte : tous ces montagnards sont aussi fautifs qu'elle ! A la maison on accueille les chemineaux, les colporteurs, les pèlerins. Celui qui passe a droit a un bol de soupe, à une botte de paille dans la soupente pour s'y reposer. Mais jamais, au grand jamais, un seul charbonnier ne s'est assis à la table des Foucher. Alors à quoi bon parler de cette rencontre à des gens qui pensent " qu'être différent, c'est être méchant ". Voilà pourquoi les huit ans de Caroline n'ont pas eu le courage d'avouer qu'ils avaient rencontré un brave homme. Adulte, elle s'en veut d'avoir été une petite fille sans courage pour affronter sa famille et peut-être le village. Protégé par ses forêts imposantes, le Morvan vit replié sur lui-même. A quelque temps de là, François décide donc d'emmener sa fille voir les coupeurs de bois. Il veut l'instruire et la distraire tout à la fois. Et surtout il veut l'éloigner d'une mère acariâtre et de bébés piaillards. Pas plus que sa petite Caro il ne supporte cette atmosphère lourde et tendue en permanence. Et pourtant, pense-t-il, on pourrait être si heureux tous les trois. Philibert et Marie, les deux aînés, se sont placés et gagnent leur vie. Depuis la Saint-Jean, Marie partie à la ville, aide une cuisinière de grande maison et adore cela. Elle est très élégante et vient de moins en moins au village. Alors François délaisse un peu ses sabots et s'occupe de sa fille. Il attelle la carriole, sort un immense parapluie bleu et le dépose fermé à l'arrière du véhicule. Ce parapluie est extraordinaire ; il est d'abord exceptionnel par sa taille respectable puisqu'il couvre toute la voiture ; ensuite il est très particulier à cause de sa fixation dans le plancher et au dossier du conducteur, ce qui lui donne une parfaite stabilité. Et cette couleur insolite, ce bleu, serait-ce le bleu " jean's " bien avant l'heure ? François prépare également une grande musette, sorte de sac que l'on peut porter en bandoulière. Il y entasse de la nourriture pour plusieurs jours. Catherine le regarde faire, elle ne pose aucune question, il ne lui donne aucune explication. Il dit simplement " Nous serons là dans trois jours, tâche que la soupe soit chaude à mon retour ! " Et les voilà partis, abandonnant Catherine à ses inséparables nourrissons. Caroline a un petit sourire narquois. A cause de l'escapade bien sûr ! Mais elle se dit que sa mère va bien être obligée de laver, et avec l'eau du puits, car elle ne va pas s'éloigner de ses protégés. Et malgré ses sabots et ses lourds cotillons, la gamine saute allègrement dans la carriole. Le soleil présent, intense, inonde la robuste carriole fraîchement repeinte en vert, du beau vert des sapins. Assise à l'avant à côté de son père, Caroline se laisse aller à sa joie. Elle retire sa coiffe et sent le vent lui caresser les joues. François remarque la bonne mine rose et enjouée de sa fille. Il bourre sa pipe et fredonne un air de fête, l'air qu'il chante à la fin des repas de noces auquel il est convié. Caroline n'en revient pas de voir son père ainsi transformé et se serre tout contre lui. " Attention ! tu vas te brûler avec les étincelles qui voltigent autour de ma pipe " bougonne-t-il. Mais Caroline ne s'émeut pas d'une telle remarque, elle sait que François ne veut pas laisser transparaître ses émotions à l'extérieur, et elle reste appuyée contre l'épaule de son père. Les moments où elle peut se frotter à la veste de toile rude sont si rares et si doux à la fois qu'elle en profite pleinement en cet instant. Ils traversent plusieurs villages très éloignés les uns des autres et Caroline s'étonne de les voir si espacés. Parfois, au détour d'un chemin, ils s'arrêtent et laissent passer quelques belles vaches, solides, d'un beau marron rouge. " La race du pays " précise François, car tu sais, il existe aussi des vaches noires, des blanches, des noires et blanches, des blanches et marron, des beiges. Mais Caroline ne le croit pas. " Papa raconte des blagues, comme le soir à la veillée, une vache, c'est rouge et puis c'est tout ". Et Caroline rit de bon cœur. François s'étonne bien un peu que la couleur de la robe des vaches fasse tant rire sa fille. Comme ce voyage transforme Caro, elle qui ne rit ni ne pleure jamais. La pipe s'est éteinte depuis longtemps et François recommence à fredonner. Ils voyagent ainsi une grande partie de la journée. Bientôt ils ne rencontrent plus aucun village. Ils traversent alors de vastes chênaies, bizarres, tordues, noirâtres. Ensuite viennent des hêtraies plus claires, plus douces, plus accueillantes. Après une montée régulière suivie de descentes et de remontées en dents de scie, on aperçoit enfin les premières masses sombres des sapins et l'on pénètre dans le sous-bois. Une courte halte permet à la fillette de se dégourdir les jambes tout en avalant un gros morceau de fromage. Caroline a soif et se précipite vers la première source. François arrête son élan et lui explique que l'eau est trop glacée pour la boire directement à sa sortie de terre. Pourtant c'est bien ce qu'elle a toujours fait ! François s'accroupit devant la source, rapproche ses deux mains en forme de petit bol, se promène un instant puis boit lentement le contenu de ses mains. A toi, dit-il. Caroline essaie d'imiter son père, mais l'eau se sauve à travers les petits doigts mal joints, et elle s'abreuve goulûment le nez dans la source. La nuit commence à descendre quand un village apparaît soudain. " Nous faisons halte chez les Gaumard, dit François, ils sont de notre famille ". L'accueil est chaud et chacun s'extasie sur la bonne mine et l'air dégourdi de la petite cousine qu'ils n'ont jamais vue. " Si ma mère pouvait sourire comme la maîtresse de maison... " pense Caroline. Et ils passent une formidable soirée où chacun donne des nouvelles fraîches des autres membres de la famille. On ne manque pas de place où coucher. La petite Caro se glisse entre ses cousines, sous le gros édredon, et s'endort immédiatement. A l'aube, l'odeur de la soupe aux légumes réveille les enfants. François et Caroline ne peuvent repartir qu'avec une foule de provisions pour offrir à Catherine, la parente restée au village. Les grands bois ne sont plus loin. Une fraîche vapeur qui stagnait au ras du sol s'élève doucement et dégage progressivement le sous-bois. Des senteurs suaves et fortes à la fois ondulent dans la futaie. La fillette aime cette odeur très particulière de la sapinière qui se réveille. Une douce luminosité matinale se glisse progressivement entre les jeunes sapins et les rayons de soleil s'amusent à dessiner de longues obliques dorées. L'air est frais et Caro, assise à l'arrière de la carriole, attache frileusement son bonnet et entoure ses jambes dans la grosse couverture de laine. Encore quelques tours de roue sur des chemins de plus en plus défoncés, de plus en plus boueux, et les deux voyageurs abandonnent la carriole. La marche réveille tout à fait la fillette. Elle lève la tête, ouvre ses grands yeux gris, emmagasine cette foule d'images qui la frappe et qu'elle restituera si fidèlement cinquante ans plus tard. Même un sapin, qui a la réputation de croître rapidement, ne devient pas un adulte bon à couper en un jour. Alors au fil des générations, on les regarde grandir puis on les abat. Une activité intense, une agitation méthodique, des gestes et des bruits précis s'effectuent dans la haute futaie. Une équipe d'hommes a investi la forêt et s'est répartie sur une vaste surface. Deux gars solides, musclés, scient énergiquement un énorme sapin. Ils scandent des cris bien rythmés pour s'encourager. Soudain ils aperçoivent François et Caroline. " Fichez le camp, ici ce n'est pas un lieu de promenade pour les citadins, déguerpissez en vitesse sinon on va vous apprendre à connaître les scieurs ! " François écarte Caroline et leur crie " Je suis Foucher, le sabotier de Mouron, vous ne me reconnaissez pas ? " " Sabotier ou pas quand tu seras écrabouillé par le géant, il ne sera plus temps, écarte-toi à vingt pas de là, et serre ta gamine ! " François obéit, mais il sait bien que, placés comme ils étaient sa fille et lui, ils ne couraient aucun danger. Les scieurs sont susceptibles et fiers de leur travail. Ils règnent en maître sur la forêt et ne veulent personne sur leur terrain. A bonne distance puisqu'il le faut, ils observent la chute du monumental sapin. Caroline est un peu triste et se demande bien pourquoi. Les arbres ce n'est pas ce qui manquent dans le Morvan. Celui-là lui était peut-être apparu plus superbe, plus fort que les autres, une sorte de roi. Elle est triste Caro mais reste plantée là, à contempler la chute incessante des grands fûts. Couchés sur le sol humide, ils sont équarris, ébranchés. Bientôt il ne reste que des troncs magnifiques, rectilignes, prêts pour le transport. Mais François et Caroline ne verront pas la suite. Il faut rebrousser chemin si on ne veut pas se faire prendre par la nuit. Ils reviendront une autre fois... Caroline se glisse à l'arrière de la voiture, s'allonge sous la couverture et s'endort. Elle est réveillée par un froid humide et pénétrant. Un brouillard dense, épais, lourd, pèse sur la montagne. Le cheval avance au pas et la lanterne forme un inutile petit halo. François saute de la charrette, la contourne, contemple le sol et essaie de se repérer. Prenant le cheval par la bride, il marche lentement, en suivant fidèlement les hautes herbes qui bordent les chemins. Il marche des heures, de chemins en bifurcations, d'intersections en chemins plus larges. Caroline est morte de peur et, tandis que le pauvre cheval marche au pas, son imagination galope. Elle se souvient des aventures extraordinaires que l'on raconte le soir à la veillée. Dans ces histoires-là, il y a toujours un brouillard intense, des gens égarés et un sinistre hibou qui hulule dans un arbre creux. Et justement, elle vient de l'entendre, cet animal qui porte malheur. Elle crie : " Papa, on va mourir ! " François se retourne, étonné, et répond d'une voix calme : " Le brouillard n'a jamais fait mourir personne, si tu as trop froid, fais comme moi, marche ! " Mais Caroline préfère se recroqueviller et s'enfouir la tête sous la bonne couverture. Le temps s'écoule lentement. La fillette somnole, sombre dans d'horribles cauchemars et se réveille plus angoissée encore. Soudain un chien aboie avec fureur. François remonte dans la carriole et pénètre dans une immense cour de ferme. " Y'a quelqu'un ? " crie-t-il. Il attend longtemps avant qu'une tête d'homme n'apparaisse. François se nomme et ajoute : " Je suis de Mouron ". Le fermier ne connaît pas ce village. Il fait entrer les deux voyageurs et les installe au chaud près de la cheminée. François demande à mettre le cheval à l'abri. L'homme hoche la tête en signe d'accord, se désintéresse de ses hôtes et retourne se coucher. Caroline et François se serrent l'un contre l'autre en attendant le jour naissant. Aux premières lueurs de l'aube ils s'éclipsent dans le brouillard. François se rend compte qu'ils sont bien loin du trajet normal et rebrousse chemin. Le soleil essaie de faire son apparition et diffuse une lumière opaque. Le brouillard devient plus léger, plus transparent. De grands lambeaux de vapeur s'élèvent du sol comme de vastes rubans obliques et voilent pour quelque temps encore un beau soleil tout neuf. Caroline est totalement réveillée et son estomac de gamine hurle sa douleur d'être vide depuis hier midi. Ils roulent ainsi une heure ou deux et François décide d'entamer les provisions. Mais auparavant il s'occupe de l'animal, lui aussi affamé. Ensuite, ensuite seulement, il coupe de larges tartines de pain et y dépose de belles tranches de jambon séché. Elles sont englouties avec délectation au cours d'une courte promenade sur le chemin encore humide. François plonge le seau dans le ruisseau et l'apporte au cheval qui s'abreuve longuement. Le soleil est déjà très haut, quand enfin rassasiés, les voyageurs égarés retrouvent le bon itinéraire. Le calme revient dans le cœur de la petite fille. Elle s'amuse des montées et des descentes. Soudain sa joie disparaît. Elle vient de réaliser qu'elle retourne vers la maison, vers une mère qui ne lui procure qu'aigreur et esclavage. Elle n'a pas envie de revoir ce visage renfrogné, ces bébés pleurnichards. Jamais un moment de tendresse, jamais un élan, jamais un petit sourire complice comme il en existe parfois entre deux instincts féminins. " C'est vraiment trop dur de revenir ; je n'aurais pas dû partir du tout " pense la fillette. Et elle qui a pépié à l'aller, reste muette au retour. Caroline décide que dès qu'elle sera capable de gagner sa vie, elle s'expatriera à Paris. Il faudra attendre encore quelques années pour qu'une fraîche petite jeune fille de dix-huit ans débarque dans cette capitale bruyante et agitée, avec en poche l'argent prêté par son père. La nuit est tombée depuis fort longtemps quand nos deux vagabonds reconnaissent la silhouette noire de leur village qui se découpe sur un magnifique ciel étoilé. François rentre la carriole, dételle le cheval. Caroline reste auprès de lui et ne se décide toujours pas à rentrer. Son père lui donne une secousse amicale sur l'épaule et lui souffle " Ne t'inquiète pas, c'est la première fois que nous partons, ce n'est pas la dernière ! " et il la pousse devant lui pour l'obliger à franchir le seuil. Face à l'âtre, assise dans l'obscurité, Catherine entretient le feu sous la marmite de soupe. Elle ne s'est pas couchée. François avait dit " Tâche que la soupe soit chaude à mon retour ! " La soupe est prête. François grogne " Va donc te coucher, tes pensionnaires ne vont pas oublier l'heure de la tétée ! " Catherine ne se fait pas prier. Tandis que les deux complices se régalent d'une bonne potée odorante et copieuse, on entend soudain un ronflement sonore qui provient du grand lit. A peine éclairés par un restant de chandelle fumeuse, le père et la fille se regardent et étouffent leur fou rire. Pour la petite Caroline, la vie reprend avec des vaisselles, des légumes à éplucher, des bêtes à soigner, du bois à rentrer, des couches à laver. Cela s'appelle les grandes vacances d'été ! Caroline ne joue jamais, elle n'a pas un instant à elle. Et plus elle grandit, plus le nombre de corvées augmente. De temps à autre, elle lit le journal en compagnie de son père. Catherine trouve indécent qu'une gamine lise de la politique, qu'elle se tienne au courant des événements mondiaux et par-dessus tout qu'elle acquière au contact de François un esprit anticlérical qu'elle conservera toute sa vie. En fait, Catherine enrage de ne savoir ni lire ni écrire. C'est ce qui éloigne son mari mais c'est ce qui rapproche le père de la fille. Lire, quelle perte de temps ! Une femme, c'est fait pour se marier et élever des enfants ! Voici de nouveau l'automne et le Morvan, tel un roi, se pare d'or, de fauve, de roux et de toutes les nuances de brun de la palette. Les oiseaux chantent moins mais ils sont partout et se gavent d'une multitude d'insectes, de chaque petite graine qui traîne sur le sol. Ils doivent être forts pour affronter l'hiver. Caroline retourne à l'école emmitouflée dans un grand châle. Ce n'est pas tant le froid qui est pénible, ce sont ces pluies torrentielles qui transpercent en totalité les épaisseurs de vêtements. Parcourir ainsi cinq kilomètres est une pure folie. On ne manque pas de parapluies à la maison. Mais essayez donc de tenir le grand parapluie noir, bien creux, bien enveloppant d'une main et, de l'autre, la gamelle et la plus grosse bûche possible pour le poêle de fonte de l'école. Essayez donc de maintenir un équilibre entre tout cela quand de brusques rafales de vent transforment votre parapluie en Montgolfière et vous entraînent en zigzaguant sur le chemin. En arrivant au seuil de la classe, Caroline retourne ses sabots l'un après l'autre car on croirait des barques coulées. L'écolière elle-même, son maigre chignon défait, semble s'être jetée dans l'Yonne tout habillée. Ce matin le gros poêle de fonte ronfle de toutes ses forces. Quelques enfants entourent déjà la précieuse source de chaleur et Caroline se glisse parmi eux. Les enfants arrivent et leur degré d'humidité dépend de l'éloignement de leur village par rapport à l'école. La mare s'agrandit autour du poêle. Le Maître pénètre dans la classe. Il tangue légèrement. Il a une manière bien à lui de se réchauffer. Néanmoins il constate le désastre et grommelle -"Vont tous attraper la crève ces chenapans". Dans un coin l'Hippolyte taquine la douce Emilie. C'est un grand échalas rigolard, une petite tête au bout d'un grand corps maigre, des bras longs et maladroits qui balaient l'espace. Il habite la plus grosse ferme du village, non loin de l'école. - Vous, l'Hippolyte, avec vos grandes jambes, filez chez votre Père. - Mais, Monsieur, j'ai rien fait de mal ! - Ecoutez donc, âne bâté, courez, mettez vos bottes de sept lieux, que pour une fois vos jambes servent à quelque chose... Dites à Monsieur votre Père que j'ai besoin immédiatement d'un seau de lait... De la traite de ce matin, compris ? Et une grosse miche. Bon sang, ne partez pas si vite, dites à Madame votre Mère que ces demoiselles ont besoin de linges secs pour essuyer leur chevelure. Tandis que le lait chauffe, les filles un peu honteuses, n'osent pas défaire leurs nattes et leurs chignons. Les convenances veulent qu'on soit présentable dès le réveil. On ne fait pas sa toilette devant la famille et encore moins devant des étrangers. Le Maître se fâche et déclare tout net : " Je ne fais pas la classe devant des sorcières, Mesdemoiselles quand vous serez présentables, nous commencerons." Les filles se cachent mutuellement et reprennent un aspect avenant. Chacun tend sa timbale à la grande Pauline qui distribue équitablement le lait bouillant. On mâche lentement le pain. Le poêle et les tuyaux sont rouges. "Attention !" dit le Maître "vous voulez donc brûler l'école !" Une douce torpeur envahit cette petite classe de campagne. Nul n'est pressé de commencer la classe. Soudain le Maître se redresse et clame : " Système métrique !" Tout est rentré dans l'ordre. Le soir Caroline raconte à son Père cette classe mémorable. François reste songeur : " Drôle de bonhomme en vérité, un jour il massacre ses élèves, un autre jour il devient paternel... A moins que..." François n'achève pas sa pensée mais Caroline comprend. Peut-être qu'aujourd'hui le Maître n'avait pas envie de faire la classe... Mais l'affaire n'en reste pas là. Certaines mères soupçonneuses insinuent que, privé de présence féminine, ce vieux célibataire a besoin de contempler des chevelures éparses. Cette chose qu'elles-mêmes ne font jamais que dans le secret de l'alcôve, leurs filles l'ont fait aux yeux de tous, de leur futur mari peut-être. Les hommes calment les femmes insistant sur le seau de lait que le Maître a payé de ses propres deniers. Dans ces villages isolés le moindre événement prend des proportions inattendues. A un automne court aux pluies violentes succède un hiver long et rigoureux. A peine les pommes ramassées, la neige tombe en abondance. Vers la mi-Novembre, un redoux facilite une fonte partielle puis un froid glacial s'abat sur le Morvan. La montagne est paralysée, coupée du monde, les communications terrestres et fluviales anéanties. Les chemins vicinaux deviennent des patinoires, l'Yonne et ses affluents gèlent, les hommes et les bêtes immobiles recherchent un peu de chaleur. Dans les chaumières les hautes cheminées flambent jour et nuit, mais n'arrivent pas à combattre le froid présent partout. Il est difficile de ravauder car les doigts des femmes sont gourds. Les hommes fument la pipe en silence, les enfants restent accroupis face au foyer, les chats s'approchent de l'âtre à s'en faire roussir les poils. Plus de veillées avec les voisins, plus de contes, plus de chants, et la vielle de François reste suspendue par ses trois clous. A l'étable les vaches se serrent les unes contre les autres, les plus hargneuses en oublient leur caractère irascible. Le cheval, plus fragile est protégé par une grosse bâche imperméable. François veille sur les bêtes et remplit les stèles de paille. Chaque jour il fait tiédir de la neige dans un vieux chaudron et oblige les animaux à boire. Et cela dure des jours et des jours. De mémoire de vieux on n'avait jamais vu cela. On se raconte, mais nul n'a pu le prouver, qu'au début du siècle, au temps du Grand Napoléon, il fit si froid que pas un jeune du Morvan ne fut enrôlé. Et cette catastrophe naturelle reçut des villageois une action de grâce. On prétendit que le ciel avait préservé les enfants du pays, voués à une mort certaine, dans ces guerres permanentes. Et les jours s'écoulent interminables. On se lève, et transis, on attend l'heure du coucher. Aux alentours de onze heures une faible clarté rappelle à François et aux siens qu'il fait jour. Quand l'horloge sonne trois heures, elle fait sursauter les êtres statufiés. Caroline constate alors qu'il fait nuit noire. Catherine a de moins en moins de lait et les bébés troublent le silence de leurs cris affamés. Rouge de honte, la fière Catherine se résout à compléter leur alimentation par de la mie de pain dissoute dans un peu d'eau tiède. Elle, la nourrice renommée, baisse la tête, c'est la première fois que cela lui arrive. Des vieillards affaiblis s'éteignent doucement, sans souffrir. Des nouveau-nés disparaissent avant même d'être baptisés. C'est une honte pour les familles car ces petits innocents n'iront jamais au Paradis. Quand le temps le permettra, on les enterrera à part, loin de la communauté chrétienne. Les animaux crèvent de froid et de faim. A la fin du printemps, quand on peut enfin sortir des habitations aux odeurs douteuses, quand enfin on retrouve les voisins, on dresse le bilan des pertes. Le fossoyeur, aidé de quelques solides gaillards, creuse sans relâche dans la terre qui dégèle lentement. Tout doucement la vie reprend, on réapprend à bouger, à parler à haute voix. Les femmes retrouvent leur énergie et recommencent à médire sur leurs voisines, ce qui est un signe de bonne santé. François retrouve ses sabots, ses outils, sa cheminée, sa pipe et son journal. Catherine retrouve son allant et sa hargne. La petite Caroline retrouve ses seaux de couches et part pour la rivière. Durant la période de gel, les bébés n'ont été changés qu'une seule fois par jour et enduits d'un peu de saindoux. Le linge souillé a été éjecté sur le bas côté de la porte et s'est amoncelé au fil des semaines. Ce matin un drame d'une violence inouï éclate entre Catherine et François. Celui-ci, à la fourche, a ramassé les couches, a fait un énorme tas dans la cour arrière et y a mis le feu. Catherine scandalisée par un tel gâchis devient hystérique et Caroline disparaît une bonne heure en attendant que cela passe. Caroline revient à pas de loup et constate un silence absolu. Catherine a ouvert la porte et la fenêtre et nettoie le sol à renfort de grands seaux d'eau. Elle époussette avec ardeur la haute armoire, l'alcôve, l'horloge, la maie couvertes d'une suie épaisse et grasse. Elle ne peut rien sortir car la terre dégèle en surface et ruisselle sous les premiers rayons du soleil. Caroline est prise à la gorge par une fumée âcre et une odeur pestilentielle : les couches ne brûlent pas mais se consument lentement. "Ma Mère a tort d'ouvrir, nous allons sentir les poils de cochons grillés pendant huit jours." pense la gamine. Le ciel bas et uniformément gris laisse entrevoir un soleil surpris et étonné de contempler cette terre qu'il avait presque oubliée. La fumée dense et opaque refuse de s'élever et stagne longtemps à hauteur d'homme. Les maisons voisines sont joyeuses de partager de si délicates effluves... Et les commentaires désobligeants soutiennent Catherine et accusent François. Caroline a raison, la fumée s'infiltre partout, imprégnant de son suave parfum chaque être, chaque objet, chaque vêtement et cela pour longtemps. Caroline part donc laver à la rivière. Elle n'a guère grandi durant cet hiver mais tout de même elle constate avec étonnement que les seaux lui paraissent moins lourds que l'an passé. Et la voilà partie, presque heureuse de sortir enfin de la maison. Elle est contente de se dégourdir les jambes. Elle traverse d'un bon pas le terre plein et pan ! Première bûche au moment où elle amorce le petit dénivelé qui surplombe la route. Là, pas de problèmes, elle marche sur le bas côté en regardant bien où elle pose les pieds. Elle traverse la route et hop ! Elle se retrouve assise au beau milieu de la chaussée. Après plusieurs essais infructueux, elle parvient à se dresser et à repartir comme un funambule, les seaux lui servant de balancier. Elle se souvient du funambule, elle l'a vu à la foire de Corbigny l'an passé. Alors toute fière, elle traverse la route les bras écartés. Mais il n'y a personne pour l'applaudir. Seul le corbeau noir qui cherche quelque maigre nourriture, fait un saut de côté à l'approche de la fillette, puis continue sa quête. Attentive, elle regarde la pente sinueuse du raidillon qui étincelle sous le soleil. Mais, c'est encore gelé ! Dit-elle à haute voix. Prudente, elle ne prend qu'un seul seau, s'agrippe au moindre branchage et attaque la descente. A aucun moment il ne lui vient l'idée de rebrousser chemin. Son instinct la guide : Elle se tient droite ou s'accroupit selon les conseils qu'il lui souffle. Lentement, très lentement elle progresse sur la pente. Soudain, elle glisse, glisse et ne contrôle plus rien. Elle serre le seau sur son cœur et attend que cela passe... En 1907, à Paris, son fiancé voudra l'étonner et l'emmènera sur un toboggan géant. Alors ? Dit-il. Et elle, froidement, de répondre : "Glisser sans pouvoir se retenir, je connais ça depuis bien longtemps, mais j'ignorais que cela pouvait être un jeu". Elle prendra un air sévère et le pauvre Arthur rencontrant les yeux gris acier dépensera une partie de sa paie de la semaine pour essayer de distraire sa Caroline. Donc, son seau de couches bien serré sur son cœur, elle dévale le raidillon sur le postérieur sans pouvoir modifier les événements. Soudain, elle bute sur un mamelon et se retrouve à plat ventre, la tête dans un buisson. Elle se redresse et finalement trouve que c'est la bonne solution. Elle se laisse glisser jusqu'aux abords de l'Yonne. Là, une surprise de taille l'attend. Le torrent est encore gelé. Personne ne s'est hasardé jusque-là et personne n'a pu la renseigner. Elle en perd son Français et s'exclame en patois : "Ca alors, ben ça alors !" L'idée de faire demi-tour ne l'effleure même pas. Elle est venue pour laver, elle va laver. Elle ne sait pas encore comment, mais elle le fera. Chaque hiver on voit apparaître une mince pellicule de glace sur le torrent, mais quelques bons coups de sabot libèrent l'eau pure. Aujourd'hui, malgré tous les efforts obstinés de Caroline, la glace ne cède pas, elle s'effrite en surface et vole en éclats comme du verre. Le torrent est pris en profondeur. Pourtant l'enfant entend le bruit assourdi de l'eau qui s'écoule. Elle jette des pierres mais celles-ci rebondissent et glissent sur la nappe scintillante. Elle se sert du tranchant de son battoir et ô ! miracle réussit à faire un trou gros comme une noix. Alors elle s'acharne et méthodiquement frappe et frappe la glace qui ose lui résister. De multiples petits trous constellent une surface grande comme la gueule du seau. "Je l'aurai" dit-elle à haute voix. Et elle continue, en nage malgré la fraîcheur du lieu. Soudain, elle s'arrête et hurle à pleins poumons : "la pelle, la pelle doit être dans les buissons !". Souvent, après un orage violent, l'Yonne ramène des graviers, des branchages, des animaux crevés, des objets divers. Quand les femmes viennent laver en groupe, elles nettoient d'abord l'étroite bande de gravillons puis s'installent. Caroline cherche la pelle et a bien du mal à la trouver. Oubliée depuis des mois, couchée, enfouie, la pelle ne laisse apercevoir que l'arrondi du manche. L'énergique gamine tire de toutes ses forces et ramène le précieux objet. Victorieuse, elle se rue vers la rivière et donne de formidables coups de pelle. La glace s'ébrèche de plus en plus. Des fentes rejoignent les trous faits par le battoir, mais toujours pas d'eau libre. Caroline perd la notion du temps qui s'écoule. Elle tape, elle frappe, elle rugit et parvient à transformer la belle surface lisse en un cahot hérissé. Maintenant, elle pioche et creuse avec le tranchant de la pelle. Et le temps passe. Sans relâche, elle éjecte du trou les morceaux de glace. Alors elle pousse un cri de lionne triomphante : elle a attrapé sa proie, elle a atteint l'eau libre. Le trou n'est pas bien grand, mais suffisant pour y glisser le seau. Elle s'agenouille dans la caisse en bois attrape son battoir, et se met à laver. C'est une horreur. Avec deux doigts elle glisse une couche dans l'eau glacée. Elle la ressort, jette la cendre dessus, frotte avec ardeur, frappe du battoir et rince. Elle frissonne. Elle a tant remué que, maintenant, immobile, elle sent un froid profond l'envahir. Et le temps passe. Maintenant, elle plonge sans hésiter les mains dans le torrent, elle relève ses manches et y plonge ses avant bras... Le contenu du seau est propre. Caroline tente de se redresser, pose ses mains sur les rebords de la caisse, mais elles ne lui sont d'aucun secours. Ses mains et ses avant bras sont violets, presque noirs. Après de longs efforts, elle se soulève et veut empoigner le seau. Elle a beaucoup de mal à refermer ses doigts engourdis. Finalement, à deux mains, elle parvient à le déplacer de quelques mètres. Elle ne sait plus très bien où elle en est. Il faut, il faut qu'elle remonte le raidillon ; Elle gravit lentement un mètre, deux mètres, pose le seau à terre et repart. Elle entend des appels, lointains comme irréels : - Où es-tu ? Caroline, ma fille, réponds, où es-tu ? Alors sortent d'elle des sons rauques qu'elle ne connaît pas : - Je suis là. Sa voix assourdie ne porte pas. Les appels reprennent, plus proches. Inlassablement elle répond : - Je suis là. Alors, tel un sanglier blessé, débouche François apeuré, effrayé devant le spectacle qui s'offre à lui. Sa petite Caroline, bleue, hagarde, méconnaissable, est là, plantée sans bouger. Il se rue sur elle, la secoue, lui parle, la serre dans ses bras, lui frotte les mains et le visage. Elle entend la voix de son père qui lui dit : - Parle, parle ma petite Caro, dit quelque chose. Comme dans un nuage, elle articule : "J'ai lavé." François devient fou de douleur. La remontée commence, lente et pénible. Il se met derrière sa pauvre gosse, et l'aide à marcher, il la pousse ou la traîne selon les difficultés du chemin. Quand ils débouchent enfin sur la route, François montre à Caroline le deuxième seau : - Tu n'es pas rentrée pour le repas, nous avons mangé sans toi. Je suis venu et j'ai trouvé ce seau. Il jure, François : "Bon Dieu de Bon Dieu ! Quelle vie !" Et d'un coup de pied envoie promener l'objet. Puis il se ravise et le rapporte. Sans bouger, Caroline entend et regarde. Ils retraversent la route qui brille sous le doux soleil. La chaleur et la lumière font souffrir la fillette. Enfin elle réagit et se plaint doucement : - J'ai mal, j'ai mal, mes mains, ma tête, ma poitrine. Elle n'en a jamais tant dit de sa vie. Debout devant le seuil Catherine attend. De sa force robuste, elle soulève sa fille, la rentre à la maison, la change, la couche, lui fait avaler la soupe restée dans la cheminée. Caroline somnole mais capte une discussion âpre et violente bien que faite à voix basses. François accuse Catherine d'avoir envoyé leur fille à la mort. D'ordinaire, quand François bougonne, elle ne réagit même pas. Mais là, elle part en flèche : - Je l'ai envoyée laver, je ne savais pas que le torrent était pris. - Tu la terrorises, qu'aurais-tu fait si elle était revenue sans avoir lavé ? - Elle aurait reçu une bonne raclée, avoue Catherine. Là dessus, toussant et gémissant, la fillette s'endort. Après deux journées passées à dormir d'un sommeil agité, la fillette assise dans le fauteuil de son père reste prostrée et ne fait rien sinon se plier sous la douleur de la toux. Pendant huit jours, Caroline s'efforce d'avaler les décoctions de plantes diverses que sa mère lui prépare. Elle accepte aussi les inhalations de menthe séchée. Mais la fièvre ne baisse pas. Des quintes de toux, violentes et sèches la secouent et lui font porter ses mains à la poitrine. Catherine a besoin d'aide. Une vieille femme sans ressources accepte de laver les couches. Elle prend l'eau du puits et se poste devant la maison. En échange elle mange chez les Foucher à midi et remporte la soupe et le pain pour le soir. La santé de Caroline ne s'améliore pas. François décide d'entamer ses économies et d'aller consulter un médecin. François emmitoufle Caroline dans la grosse couverture. Il attelle la carriole, emballe les pattes du cheval de vieux sacs de jute bien rêches. Les chemins peuvent encore être glissants pense-t-il. Alors, tenant la bride, il marche à côté de l'animal. Il marche ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'il arrive sur les hauteurs tout à fait dégagées. Enfin, il grimpe dans la carriole et s'en va lentement vers la ville. Pour vivre dans ce coin perdu, il faut avoir l'âme bien trempée et posséder une santé de fer. Ce médecin de campagne, est un homme de forte corpulence, jovial. Il parle le patois mieux que le français et il a su se faire respecter. Quand les villageois l'appellent, il est généralement trop tard : Le médecin et le curé se croisent au seuil de la ferme. Quand ils viennent au cabinet, c'est que le rebouteux n'a rien pu faire ou que les plaies sont salement infectées. Les malades ne veulent pas payer. L'argent, c'est fait pour acheter une bête, une terre, pas pour se soigner. Alors ils rechignent, mais le médecin ne s'en laisse pas conter. Il les connaît et dit : "Quand la vache aura vêlé, vous viendrez me régler avec la vente du veau." Des plus démunis, il accepte une volaille, des œufs, un bout de lard. François entre dans le cabinet du médecin suivi de Caroline tremblante et fatiguée. "Tiens, je ne les connais pas ceux-là, jamais vus." Il s'adresse à eux en patois mais François lui répond en Français. De plus en plus intrigué, il écoute le récit : L'Yonne gelée, le lavage des couches... Caroline, dans son coin, tousse éperdument. "Approche, petite" dit-il. Il emmène la fillette derrière un rideau, l'ausculte et la renvoie vers son père. Tandis qu'il se lave les mains, il hurle d'indignation. Il agonit François à qui on en n'a jamais tant dit. Connaissant son père, Caroline a peur et veut intervenir. Mais François encaisse sans broncher. Caroline n'en revient pas. François attend et finit par dire : "Je vous dois combien ?" Le médecin reste pantois : L'homme qu'il vient de traiter d'assassin veut le payer. Décontenancé le brave médecin dit : "Vous prendrez bien une petite goutte avant de repartir, le chemin est long". François accepte et les voilà qui parlent, qui parlent, de foires, de politique. Caroline s'impatiente et tire sur la manche de son père. François paie la consultation et promet de revenir discuter lors de la prochaine foire. Le médecin donne toute une réserve de médicaments pour la fillette. Une solide amitié, faite de sympathie et de respect de l'autre, de joie de vivre et de concordances d'idées, venait de naître entre le médecin du gros bourg et le sabotier du village. Et, chaque fois que François en aura l'occasion, il viendra discuter et boire une "petite goutte" avec son ami le médecin de campagne. Il faudra six mois avant que Caroline ne soit complètement rétablie : contusions multiples, gelures, congestion de tout le tronc et en particulier, double pneumonie. Un printemps tardif mais resplendissant apporte des bouffées de douces senteurs des bois. Le soleil redonne vigueur et joie à tous, même aux vieillards. Petit à petit, Caroline retrouve des forces et tousse moins. Pleine de bonne volonté, elle apporte une aide lymphatique à une mère bouillante d'énergie. La vieille dame continue de venir laver les couches et l'on entend François chanter à tue-tête dans son atelier grand ouvert... La vie a repris son cours... De cet hiver long et glacial, le village a souffert plus qu'il n'y a paru au premier abord. En particulier, les toitures un peu anciennes n'ont pas résisté à la fonte de leur épais matelas de neige. L'humidité a victorieusement eu raison des chaumes. Or, tout ce qui de près ou de loin pouvait ressembler à de la paille, a été utilisé. Outre l'usage normal pour les animaux, les portes et les fenêtres ont été calfeutrées. Les granges sont désespérément vides. Que faire ? A des heures de marche à la ronde tous les villages se posent le même problème. Alors on se souvient qu'il existe, quelque part, pas très loin, des pierres grises qui se découpent toutes seules, des pierres qui font du bruit quand on y pose le pied, des pierres qui "chantent." Et, de chaque village sortent les charrettes et les hommes de lieux différents se rejoignent, se parlent, s'apostrophent, de vieilles connaissances se reconnaissent après des années de séparation. Un formidable élan, une énergie débordante, nés de ce cataclysme, explosent sous le soleil renaissant. Pendant des jours et des semaines on aperçoit le va et vient des charrettes. On découvre les toitures, on arrache les vieilles "poutres", et tant qu'à faire, on supprime les chaumières dangereuses. L'organisation s'est faite spontanément. Tandis que certains plus mal habiles peut-être, continuent de charrier la pierre, d'autres plus adroits attaquent la reconstruction. Reconstruire oui, mais quand on abat une masure, il faut d'abord accueillir les gens et leurs bêtes ainsi que tout leur avoir en meubles et en matériel agricole… Et cela jusqu'à ce que la nouvelle maison soit habitable. Ce n'est pas une mince affaire. Curieusement, ce ne sont pas forcément les amis de longue date qui offre l'hospitalité. Du coup, de nouvelles relations se créent et que l'on espère éternelles ! Et les femmes dans tout cela, vous croyez qu'elles se tournent les pouces ? Elles rassemblent des tonnes de nourriture, elles vident les tonneaux de petit salé, elles tuent lapins et poulets, elles passent leur temps en cuisson, en vaisselles géantes. "Ca mange encore plus qu'à l'ordinaire des hommes qui travaillent dur ! Et même ça dévore !" Mais elles restreignent la boisson. "Vous ne voyez pas que nos maisons soient de travers pour un petit coup de trop !" Chaque maison est prise en charge à tour de rôle par tous les bras valides. On rebattit, solide et pour des générations. Les villages aux toits fauves se métamorphosent en bourgades aux jolies toitures aux reflets argentés. La tradition ne sera pas abandonnée : chaque toiture recevra comme jadis son bouquet de fleurs des champs. Et l'on boira jusqu'à en oublier où l'on habite sous le regard indulgent des femmes. Et maintenant ? Pas le temps d'admirer son beau village tout neuf, pas le temps de souffler, la terre appelle au travail, aux semences. "Nous avons pris pas mal de retard, va falloir mettre les bouchées doubles ! " Et là, vraiment, la vie reprend son cours avec ses heures de dur labeur, ses jalousies, ses fâcheries, ses médisances et ses haines qui, comme les amitiés, se veulent éternelles. Deux années s'écoulent sans faits notables. François se sent de nouveau des fourmis dans les jambes et un besoin irrésistible d'évasion. Emmener ma petite Caro voir le flottage du bois, la sortir de ce trou perdu, pourquoi pas ? Il faut compter une bonne semaine d'absence, si tout se passe bien. Bon, dès son retour de l'école, je lui en parle. Pour Catherine ? Bah ! je lui dirai toujours trop tôt. Le plus tard sera le mieux. Et François sifflote de joie dans la bonne odeur de copeaux éparpillés à ses pieds. Mais ce soir-là, comme par hasard, la gamine est submergée de travaux ménagers. Pas un instant pour s'isoler dans l'atelier. Demain, demain je trouve un prétexte pour un tête-à-tête, bougonne-t-il ! Alors François pour se détendre, bourre sa pipe et se dirige calmement vers l'encadrement de la porte de l'atelier et s'y adosse. Humant l'air frais de sa montagne, le regard errant sur les belles teintes du soleil déclinant, il se prend à rêver… La voix acide de Catherine lui rappelle que c'est l'heure de la soupe. Il se déplace avec une certaine lenteur vers la maison, ce qui a le don d'exaspérer sa femme. Une bonne soupe de légumes, bien épaisse, est déjà servie dans les bols géants. Il aime cette soupe-là, et d'habitude il émet de petits grognements de satisfaction. En l'écoutant, Caroline pense que son Père ronronne comme un jeune chat. Mais ce soir il l'avale à vive allure, au risque de se brûler et n'y prête aucune attention. Catherine s'inquiète : - Est-ce trop cuit, pas assez salé, enfin quoi ? - Toujours bonnes tes soupes ! Je me régale, tu vois, j'ai fini ! Pourtant comme sa Mère, intuitivement Caroline sent bien que son Père est ailleurs… D'aussi loin que Caroline se souvienne, chaque soir son Père s'assoit sur le banc près de la cheminée, allume sa pipe, regarde les volutes de fumée, tandis que les femmes font la vaisselle. Mais aujourd'hui, à peine le dîner avalé, François ressort fumer la deuxième pipe de la soirée tout en arpentant le terre-plein. Et pour une fois, la mère et la fille, muettes, semblent être d'accord pour penser que l'homme de la maison ne tourne pas rond. |
| Claudette Prévot |