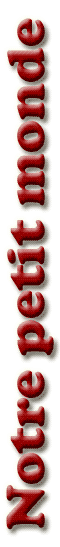![]()
 |
|||
| Impressions de guerre d'une paetite fille heureuse | |||
|
|||
Exode |
|||
Août 1939 s'achève joyeusement. Il fait beau et nous prolongeons nos vacances. La rentrée scolaire est encore loin, au premier octobre. D'ailleurs, Pierrette et moi n'avons que cinq ans et l'école maternelle n'est pas obligatoire. Depuis quelques jours Papa et Tonton Pierre ont repris le travail. La vie continue, tranquille, Pépé Arthur ramasse fruits et légumes. Mémé Caroline fait des conserves. Tata Zabeth écrit de longues lettres à son mari qui ne revient que le dimanche. Maman tricote pour toute la famille... Et nous, les quatre cousins, nous continuons à faire des bêtises. Soudain, l'atmosphère change. La T.S.F. fonctionne toute la journée. Elle hurle cette horrible radio, plus de jolies chansons tendres, plus d'histoires drôles comme à l'ordinaire. Non elle parle, parle, de la même voix d'homme toujours sur le même ton. Ca m'énerve, je veux l'éteindre, mais grand'mère m'éjecte d'une secousse et me crie : "Ne reste pas dans mes jambes, et laisse la radio tranquille, sinon gare." Je sors en trombe de la maison et file jusqu'au bassin de pierre. J'aime ce bassin, ses vieilles sculptures, sa mousse verte, son humidité qui t'imprègne quand tu te mets sous le vent. Je regarde les gros poissons gris qui s'ennuient autant que moi. Le jet d'eau sort de la statue, et retombe en fines gouttelettes sur la surface pleine de jolis reflets. Je reste là longtemps, mais les poissons se cachent sous les herbes. Je rentre à fond de train et ne reconnais pas la maison. Un désordre, un désordre dont tu n'as pas idée règne dans cette maison. D'ordinaire Pépé Arthur regarde les trois femmes s'activer et ricane malicieusement en disant : "Une place pour chaque chose, chaque chose à sa place, hélas ! Dans cette maison tout est tiré au cordeau, pire que dans mon jardin, franchement ça manque de fantaisie." Mais aujourd'hui, il est servi grand-père, du désordre, il y en a ! Fébrilement les femmes font les valises, y enfournent des choses précieuses qui n'y étaient pas au début des vacances. Mémé cache l'argenterie dans les clapiers vides puis y ajoute de la paille. Elle inspecte les armoires et récupère de petits objets auxquels elle tient. Elle les glisse dans les moindres interstices des bagages et bientôt il est impossible d'ajouter quoi que ce soit. La déclaration de guerre sème la panique dans les foyers. Jean, mon Père, et Pierre sont mobilisés. Ils disparaissent de notre univers. Et c'est l'attente, l'attente interminable d'événements qui ne viennent pas. Une semaine passe, puis deux. C'est la guerre mais rien n'a changé dans la vie quotidienne. Ce qui a changé c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les trois femmes ne sont plus comme avant la confection des grosses valises. Elles ne les ont pas vidées, mais on a besoin de nos habits. Elles nous obligent à mettre des affaires un peu justes qui sont restées dans les armoires. Elles ne sourient plus, les femmes, elles nous envoient promener, elles n'ont plus envie de jouer avec nous. Et nous les grandes de cinq ans on se dit que si c'est ça la guerre, ce n'est pas amusant. Ce qui a changé c'est l'atmosphère mais en 1939, la fillette que je suis, ne connaît pas ce mot. Et puis tout doucement la vie reprend son cours. Tante Zabeth rentre à Reims avec ses filles et son embonpoint qui augmente chaque jour. Le bébé est prévu pour Noël. Maman, Dédé et moi repartons pour Villemomble. Nous reviendrons tous à Jouarre pour fêter Noël, à moins bien sûr que la guerre change nos projets. Les mois passent. Chaque semaine Maman écrit à ses parents et à sa sœur et reçoit deux lettres en retour. Maman cultive notre petit jardin, s'occupe de nous et tout va bien sauf que Papa n'est pas là. Vers la mi-décembre, tata revient chez ses parents et Bébé Jean-Pierre naît à Jouarre. En Février Papa arrive à Villemomble habillé en militaire marron. Je le trouve très rigolo avec son petit calot et il me le prête. Mais il se remet en civil, comme il dit. Il fait un froid de loup, nous avons du mal à chauffer. Comme il a beaucoup neigé on fait un immense bonhomme de neige et Maman prend des photos. Papa dit qu'il ne se passe rien sur le front. Les soldats attendent les Allemands, mais ils ne les ont ni vus ni entendus. Au bout d'une semaine Papa repart. Le printemps arrive. En mars nous retournons à Jouarre chez les parents de Maman. Et de nouveau la joie règne. Pépé entoure ses cinq petits-enfants de sa tendresse et de son éternel bonne humeur. Le joli bébé blond aux yeux bleus nous attire comme des mouches et Tata nous chasse car nous passerions notre temps à l'étouffer sous nos bisous. Les grandes personnes écoutent chaque jour la T.S.F. Mars s'achève. Soudain, exactement comme en Septembre, l'atmosphère change. A nouveau les femmes bouclent les valises desquelles elles avaient sorti un minimum de choses. Les Allemands enfoncent tous les fronts et vont bientôt arriver sur la Marne qu'ils connaissent bien. Nous fuyons devant cette possibilité : nous partons en exode. Les femmes emmènent les enfants. Pépé nous rejoindra plus tard. Ah ! Ce voyage, une pure folie ! Cela ne ressemble en rien à tous les voyages que nous avons pu faire avec nos parents. Un petit voyage à Dieppe pour passer la journée à la mer, un petit voyage à Strasbourg, en dormant assis dans le train, c'était bien. Mais là, tu attends, attends, et tu ne sais même pas s'il y aura un train. Le quai est plein de monde, de valises, de malles, de chiens ; de gosses, de vieux, et pour mettre un peu d'ordre dans tout cela, de jeunes femmes comme ma mère ou ma tante. Et tu attends encore. Un train arrive, la foule se rue, les enfants bousculés perdent leur mère et pleurent. Chacun pour soit, il faut monter dans ce train. "C'est peut-être le dernier avant l'arrivée des boches" dit une grosse bonne femme qui m'aplatit sur la porte ouverte du wagon. Elle monte, nous montons aussi. Personne ne sait où va ce train, personne ne sait où il s'arrêtera, ni jusqu'où il pourra aller, ni quelle est sa destination finale. Quand le chef de gare peut enfin obtenir des indications précisant l'itinéraire et nous les transmettre à l'aide d'un porte-voix, c'est l'horreur. Des gens coincés dans les couloirs veulent redescendre. Ils écrasent ceux qui se sont déjà assis sur les valises, rentrent leurs volumineux bagages dans les estomacs qui se trouvent sur leur passage. Ils veulent ressortir, c'est aussi simple que cela. Finalement toutes les grandes personnes décident de descendre, et évacuent le couloir. Les enfants gardent les bagages. Sur le quai les femmes organisent la remontée. Ceux qui occupent le milieu du couloir montent en premier. Ceux qui ont leurs affaires aux deux extrémités du wagon, grimpent les derniers. Ils se coincent le long des portes qui ont bien du mal à se refermer. Les gens assis dans les compartiments n'ont guère plus de chance. En principe, un compartiment est prévu pour huit personnes assises, des filets pour mettre les bagages, une porte pour être tranquille chez soi, des rideaux qui se coulissent de haut en bas pour faire l'obscurité totale et une petite veilleuse pour la sécurité. Un petit confort ; même en troisième classe où les banquettes sont en bois, tu finis par t'installer agréablement. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas ! Entre les rangées de jambes des voyageurs assis, d'autres individus ont glissé leurs valises, et se sont installés dessus. Personne ne peut bouger. Au bout d'un moment, une femme crie : "J'ai une crampe, il faut que je bouge les pieds". Une femme en 1939, ça porte une robe, des bas, des chaussures à hauts talons, il lui est impossible de s'accroupir sur son siège comme les gamins. Aucune femme ne porte de pantalon, sauf les femmes osées. Tout le compartiment s'agite donc et permet à la dame de remuer un peu ses pieds ; elle remercie tristement. Le train roule longtemps. Assise dans le couloir, je somnole bercée par le mouvement cadencé. Ma tête heurte de temps à autre le coin de la baie vitrée, j'ouvre un œil puis je repars dans mes vagabondages. Maintenant il fait nuit. Le train roule encore, sans chauffage, sans éclairage. Je voudrais bien aller aux toilettes, mais c'est impossible. La place assise sur le siège des toilettes a été gentiment offerte à tante Zabeth et son bébé par un monsieur qui s'est mis debout dans le soufflet entre les deux wagons. Tata et ses filles sont certainement les voyageurs les mieux installés de ces gens qui partent Dieu sait où. Combien de temps vais-je pouvoir me retenir ? Soudain, c'est le miracle. Le train ralentit, freine dans un grincement que je trouve merveilleux ; on va s'arrêter. A l'extérieur une forte voix d'homme crie : "Vierzon, tout le monde descend avec ses bagages !" Une voix de femme ajoute : "Une soupe chaude attend tout le monde, des lits de camps sont dressés dans la salle d'attente, le train ne repartira que demain matin. Venez !" Des infirmières de la Croix-Rouge nous accueillent avec le sourire malgré l'heure tardive. Tout se passe bien. Mais la chose la plus importante pour moi c'est de me baisser sans plus attendre et de faire pipi sous le ballast le long du train... Je ne suis pas la seule... La soupe me paraît délicieuse, moi qui fait toujours un tas de chiqué pour manger. On s'installe pour la nuit. Il fait froid : un petit courant d'air glacial se glisse sous mon lit de camp et finalement je suis mieux à même le sol, roulée dans une couverture un peu rêche. La nuit, n'est pas une bonne nuit comme chez Mémé où tu rabats le gros édredon sur tes yeux pour t'endormir. Ce grand hall plein de monde abrite un chœur qui chante faux : quelqu'un tousse, une autre toux lui répond, le gémissement d'une vieille apporte sa contribution, les pleurs d'un bébé ajoutent quelques notes aiguës à cette chorale de campagne mal dirigée. Un chien se balade et vient te lécher le nez, un monsieur âgé se lève dix fois et ouvre toute grande la porte qui grince. Tu as aussi les gens qui parlent tout haut et ceux qui ne dorment jamais, le monsieur très bien qui va en appeler à la Direction de l'obliger à une telle promiscuité... Bref une superbe nuit inoubliable, comme il s'en produit rarement dans une vie. Au petit matin, les dames de la Croix-Rouge viennent nous annoncer le petit déjeuner. Elles font un peu de discipline : "Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde" La plus jeune ajoute malicieusement : "Il y aura même du rab comme à la cantine" Je ne mange pas à la cantine et je n'ai jamais mangé de rab. Le "rab" (râble) pour moi c'est du lapin en sauce. Je me tourne vers Maman et demande : "Est-ce qu'elles vont donner du lapin au petit déjeuner ?" Maman ne comprend pas ma question. Je répète : "La jeune infirmière a dit qu'il y aurait du rab." Malgré la situation, Maman pouffe de rire, appelle Mémé et Tata Zabeth et leur raconte ma dernière. Je reste plantée là devant ces trois adultes qui n'arrêtent pas de rire. C'est énervant à la fin, les autres personnes n'ont pas ri de la jeune infirmière, pourquoi ma famille rit-elle de moi ? J'ai dit la même chose qu'elle ! Quand enfin Maman se calme, elle se tourne vers moi et commence à m'expliquer : " Le rab c'est... et elle recommence à rire. Je n'en peux plus, je crie : "C'est quoi ?" Les personnes qui nous entourent me trouvent mal élevée de crier ainsi en public et manifestent leur réprobation. Maman s'approche de moi et me dit tout bas : "Rab, cela veut dire rabiot, avoir du supplément, comme deux parts de tarte aux pommes, tu comprends ? Mais ne répète pas ce mot, c'est un gros mot." J'accepte l'explication, n'empêche que ce gros mot-là les a bien fait rire ! "Du café chaud pour les adultes, du lait pour les enfants" dit la plus âgée des infirmières, en déposant d'immenses chaudrons sur une table improvisée, faite de tréteaux et de longues planches. Elles apportent aussi des pains de quatre livres, du gros pain qu'elles taillent en énormes tartines. De vieux messieurs sortent leur couteau de poche et les aident. Maman tend le biberon de Dédé. La vaste louche s'écoule tant dans le biberon qu'autour et en masque les graduations. Maman essuie le trop plein et emporte le précieux liquide. Elle fouille au fond de son sac à main et en ressort deux morceaux de sucre emballés dans un mouchoir de fine dentelle. Maman a toujours du sucre dans son sac (Claudette aussi !) Et aussi de l'alcool de menthe pour le cas où l'on aurait mal au cœur. Dédé boit son lait, mais la tétine se bouche. Maman enlève cette tétine, la nettoie et Dédé se précipite sur le biberon qu'il vide complètement bien que bouillant. On me donne une timbale en fer blanc, brûlante que j'ai du mal à tenir. Au-dessus, surnage la peau, la crème de lait qui a bouilli : une horreur, mon cœur se soulève et je dépose ma timbale dans un coin. Je bois une gorgée de café dans la tasse de maman : ça, c'est bon. (Dans ma famille on m'appelle Miss Passette, car cette petite passoire est pour moi plus indispensable que tout autre chose.) Le train revient sur le quai après avoir dormi je ne sais où. Les gens se précipitent de nouveau comme des fous, abandonnant un désordre inimaginable. Peu de personnes ont plié les couvertures sur les lits de camp. Des verres, des timbales, des papiers gras traînent partout. C'est comme sur la place du marché après la foire. Tirée par un bras, je suis Maman. Nous nous réinstallons dans notre couloir. Le train repart. Au milieu de l'après-midi, il s'arrête en pleine nature sans aucune explication. Les gens s'éparpillent dans les hautes herbes et reviennent soulagés vers la locomotive. Un autre train arrive en sens inverse et déverse lui aussi ses passagers. Les mécaniciens et les chauffeurs bavardent. On regrimpe dans le train qui roule jusqu'au soir. Là, c'est fini pour lui, il a assez travaillé. C'est son terminus. Des michelines emportent les voyageurs dans plusieurs directions. En fait, les trains font n'importe quoi. Vierzon, là où l'on a dormi, c'est trop loin pour nous, pas dans le bon sens. Vierzon, c'est un peu dans le même coin que Tonton Joseph, le frère de Pépé. Lui, Joseph il habite près d'une rivière qui s'appelle le Cher et où l'on peut se baigner. Nous on veut aller dans le pays de Mémé Caroline. Ca s'appelle la maison du Morvan. Et c'est là qu'on veut aller, pas ailleurs. Après plusieurs journées, et plusieurs changements de trains et de michelines, on finit par arriver dans une ville qui s'appelle Clamecy. Là, il n'y a plus rien. Des habitants de cette ville font payer très cher pour nous conduire en voiture à cheval jusqu'à une autre ville, Corbigny. Nous sommes abandonnés sur le bas côté de la route. Les habitants de Corbigny prennent le relais et nous conduisent vers le village de Mémé. Il s'appelle Thaveneau. La carriole nous dépose sur le bas-côté de la route. Nous sommes exténués. Nous restons figés quelques instants respirant l'air qui sent si bon. Cela nous secoue et toute la famille se met à marcher en même temps. Il y a si longtemps que nous n'avons pas utilisé nos jambes. Mémé se fait reconnaître des voisins et demande sa clef. Mon cœur est heureux, heureux, je vais me plaire, je me plais déjà, je veux rester là toute ma vie. Je m'assois sur le talus, dans l'herbe... Et je m'endors. Je dors longtemps quand, soudain, je suis réveillée par une merveilleuse odeur d'omelette au lard. Une omelette ! Mais j'ai faim ! Cela fait presque une journée que je n'ai rien avalé. Je cours vers la maison, enjambe un banc. Mon nez arrive à la hauteur de la table. Je tends mon assiette. Tout le monde rit. J'ai dormi deux heures. Les femmes ont eu le temps d'épousseter partout, de chasser les toiles d'araignée, de faire cuire des pommes de terre à l'eau. Une voisine a prêté les œufs, le lard, le pain et le fromage. Un festin... J'avale sans regarder autour de moi, sans me soucier des mouches qui volent ni du décor qui m'est totalement inconnu. Les femmes laissent la vaisselle sur la
table en attendant que l'eau chauffe dans
la cheminée. Elles fouillent dans
une grande armoire, trouvent des draps et
font les lits. Nous venons de prendre possession
de notre chère Maison du Morvan. Montpellier, le 23 février 1996 |
| Claudette Prévot |