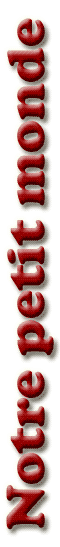![]()
 |
|||
| Impressions de guerre d'une paetite fille heureuse | |||
|
|||
La maison du Morvan (Printemps 1940) |
|||
|
La fuite devant l'arrivée des Allemands sur le territoire français, "l'exode", nous a conduits dans un minuscule hameau du Morvan, appelé Thaveneau... C'est là que Mémé Caroline avait passé toute son enfance. C'est le printemps, mais les journées sont déjà longues et belles. Par la porte ouverte un agréable soleil couchant pénètre et éclaire la pièce. Il y a dix-sept mois que Grand-Pépé François a été enterré au cimetière du village, mais la maison est aussi belle et agréable que s'il était parti faire une courte promenade digestive après le repas. Une longue table et des bancs coupent la salle. Des chaises paillées occupent un coin. L'horloge à balancier sonne toutes les demi-heures. La maie, un grand coffre en bois très ouvragé, brille sous la lumière du jour déclinant et attend que l'on y pétrisse le pain. La grande armoire qui va jusqu'au plafond fait admirer ses portes sculptées et devient brun-rosé. Cette armoire ouverte, on aperçoit des planches ornées d'une bordure de dentelle et du linge à ne plus savoir qu'en faire : des gros draps de toile écrue qui vous râpent les fesses, des taies de polochon aux initiales de la Grand-Mémé, des taies d'oreiller vastes comme des nappes et des serviettes de tables si grandes qu'elles servent de draps de berceau à Jean-Pierre. La cheminée flambe avec ardeur car malgré la chaleur extérieure, c'est notre seule possibilité de faire cuire à manger. Au fond de la pièce un grand lit à alcôve recouvert d'un énorme édredon d'un rouge un peu fané attend notre sommeil. Il y a d'autres pièces derrière et une petite chambre glaciale à l'étage. Dans l'ombre, près de l'entrée un bel évier de pierre permet de faire la vaisselle et d'évacuer les eaux sales. Deux fenêtres, ce qui est exceptionnel dans ce village, donnent une grande luminosité à la pièce. La porte est un solide panneau de bois plein. A l'intérieur de la pièce, au-dessus de la porte, un énorme bouquet de buis, fané, poussiéreux qu'il faudrait bien jeter. Non, me dit Mémé Caroline, mes vieux pensaient que ce buis bénit le Jour des Rameaux protège la maison et ses habitants de la foudre. Ici, l'orage est violent, tu verras ! Mais ce soir je ne pense pas à l'orage. J'ai presque cinq ans et je suis heureuse, incroyablement heureuse. Impossible d'expliquer pourquoi j'ai l'agréable sensation d'avoir été adoptée par La Maison. Un peu comme si, elle et moi, on se connaissait depuis toujours. Et pourtant je ne suis jamais venue là. Mon arrière-grand-père François est venu à mon baptême à La Ferté. Je ne me souviens pas que mes parents m'aient emmenée à Thaveneau étant bébé. Bon, je ne cherche plus. En tous cas entre elle et moi c'est le coup de foudre. Dans ma joie, je prends mon élan depuis la porte et je me jette à plat ventre sur le gros édredon. La réplique ne se fait pas attendre : "Ici, comme ailleurs, les chambres sont interdites en dehors des heures de nuit, et ce n'est pas parce que les lits sont dans la salle qu'on doit tout se permettre" La règle n'a pas changé, la tape sur les fesses non plus. Alors commence une vraie vie de bonheur. Mémé Caroline nous fait parcourir le village et nous présente à chacun. Malgré nos bouilles pâlottes de citadins nous sommes bien accueillis. Je trouve que les gens sont un peu rouges mais Maman m'explique que le grand air hâle les visages. Un après-midi nous dégringolons comme des fous la sente qui débouche sur la rivière. Alors là, la surprise est de taille. Mais qu'est-ce qu'elle a donc à s'agiter comme ça ? Je connais la Seine. Quand on va à Paris faire des achats à la Samaritaine, on se promène sur les berges sans déranger les pêcheurs. Ensuite on se poste sur le pont pour regarder les péniches. La Seine est une gentille rivière bien calme, bien plate, bordée de ciment. Je connais aussi la Marne. Elle est large et calme comme la Seine. La Marne est plus jolie que la Seine car elle est entourée d'arbres. On peut y faire de la barque et s'y baigner, si on aime ça évidemment. Mais la rivière de chez Mémé est encaissée, étroite, profonde au milieu. Elle court vite, fait des vagues et de la mousse en se heurtant aux gros cailloux. Et surtout elle est assourdissante. Tu dois parler très fort si tu veux qu'on te réponde. Moi, cette rivière ne m'inspire pas confiance. Tante Zabeth m'apprend à faire des ricochets. Je prends un caillou, je lève le bras droit très haut, très raide et je lance le caillou de toutes mes forces. Le résultat est décevant, le caillou tombe à un mètre de la rive, je suis aspergée par trois gouttes d'eau et je piaille. Ma tante tient le caillou près de son corps, se penche sur le côté droit, met le coude sur sa hanche. D'un geste rapide elle jette le caillou bien à plat, "A l'horizontal" comme elle dit. Le caillou fait trois bonds avant de disparaître. Toute la famille applaudit. Mais il est temps de remonter préparer le repas. La grimpette est dure pour nos petites jambes et nos mères nous poussent un peu dans le dos pour nous aider. Nous mourrons de faim. Comme les journées passent vite ici, comme je suis heureuse, de vraies vacances... J'en oublie l'absence des hommes, Papa, Tonton Pierre et Pépé. J'en oublie La Guerre, mais c'est quoi la guerre ? A table les femmes discutent. Maman dit : Ce petit village de Thaveneau, perdu dans l'Yonne boisée et mamelonnée, les "boches" ne le trouveront jamais ! Ce n'est même pas sur la carte d'Etat-major. Ca, c'est sans compter avec l'intelligence des Allemands. Nous avons mis trois jours pour venir de Jouarre (Seine et Marne) jusqu'à Thaveneau, commune de Mouron (Nièvre). Les Allemands arrivent en tractions-avant noires, des voitures françaises, quatre jours après notre arrivée au village. Fuir devant eux et se faire rattraper à l'arrivée, quelle tristesse. Nous sommes morts de frousse, les Huns et Attila n'étaient rien à côté de la description faite par Mémé Caroline. Elle a vécu la guerre de 14-18 et elle les connaît, les "Chleuhs". Mais ceux qui viennent à nous parlent français, sont charmeurs, connaissent Paris que les villageois eux n'ont jamais visité. L'un a fait l'Ecole du Louvre, deux autres le Conservatoire de Musique. Et, ce qui est un comble, certains s'occupaient, en temps de paix, de relations diplomatiques ou commerciales avec notre pays. C'est l'armée de métier, qui a de la classe, des bonnes manières et dont l'accent n'est pas plus rocailleux que celui de certains paysans du coin. Dans ma tête de petite fille la peur cesse dès le premier contact. Pourtant, deux choses me gênent : cette façon détestable de s'habiller d'une couleur atroce, ni vert, ni marron ; et puis cette façon de marcher, raide comme des piquets, ils ne peuvent pas être souples comme tout le monde ! Mais ce qui révolte les adultes, c'est la réquisition des logements. La grande ferme est occupée par un état-major et chacun doit fournir au moins une pièce. Je ne vous raconte pas la tête de la veuve dont le fils est au front et qui doit céder la chambre de celui-ci à l'ennemi... Sur la cheminée trône une photo du fiston en uniforme et elle veut "suicider son officier". Bien que nous soyons nombreux, il nous faut céder la chambre du fond, celle qui a une fenêtre et une cheminée. Le nouvel occupant est grand, mince, blond et paraît plus jeune que mes parents. Un soir, en rentrant à la maison il entend Jean-Pierre qui n'a que quelques mois. Les femmes sont chez la voisine et l'enfant pleure. Délicatement, il sort l'enfant de son berceau, le promène en chantonnant. Les pleurs cessent. Ma tante arrive comme une folle, voit le spectacle, arrache le bébé des mains de l'ennemi et le recouche. L'homme ne saisit pas tout de suite le geste de cette femme et puis il réalise : elle pense que j'allais lui faire du mal. Il dit : "Non, non, j'ai un bébé, moi aussi, exactement le même." Il déboutonne sa veste, sort son portefeuille et nous montre la photo de son enfant. La ressemblance est frappante, deux petits blondinets, dont les yeux clairs illuminent les mêmes visages allongés. Ma tante, hors d'elle, s'interpose entre l'homme et le berceau. "N'y retouchez jamais !" hurle-t-elle. Le soldat répond calmement : "J'aimerais être dans ma famille, mais je suis un soldat et je fais mon devoir." Et il s'éloigne vers sa chambre... en pleurant. Je ne savais pas qu'un homme, surtout un soldat, ça pouvait pleurer ! Beaucoup plus tard, j'ai compris cette ressemblance : Les grands-parents de Jean-Pierre sont des Vosgiens, l'Allemand lui, est natif de la frontière, juste de l'autre côté. Peut-être que dans les temps anciens ce coin de terre était un seul et même pays, peut-être que ces deux petits avaient des ancêtres communs, qui sait ? La soirée s'annonce calme. Mais quand les trois femmes, Mémé, Tata Zabeth et Maman ne prononcent pas un seul mot, c'est que le feu couve ! Gare à nos "côtelettes". Nous les quatre cousins et cousines, nous avons tout intérêt à être "mignons". (Inachevé Mars 1996 ) Une bonne soupe de légumes, bien épaisse, une bonne tranche de lard salé régalent toute la tablée et semblent faire oublier la rancœur des femmes. Mignons, nous le sommes sans difficulté aucune. Epuisés par une journée au grand air, nous venons nous asseoir près de la cheminée, somnolents et rêvasseurs à souhaits. De vrais enfants modèles ! Mémé nous bouscule et nous écarte pour attraper le gros chaudron où l'eau frémit pour la vaisselle. Le jour décline, le soleil couchant envahit la salle. Dans la cheminée les flammes deviennent de plus en plus courtes puis seule la bûche scintille. Quelle merveilleuse maison ! Quel bruit, quelle agitation ! J'ouvre un œil que je referme aussitôt, aveuglée par une lumière intense. Je respire profondément. Une odeur délicieuse de café au lait et de pain grillé me fait ouvrir le deuxième œil. Toute la famille déjeune sans moi... Je ne me souviens même pas m'être couchée. Je me laisse glisser le long de l'énorme matelas de plumes, comme sur un toboggan, passe vaguement mes mains dans la cuvette, prononce un bonjour inaudible et viens m'installer devant un bol fumant. Et la famille rit. Et la famille rira toujours, surtout mon mari, étonné de voir sa jeune mariée s'endormir à table ! Il fait un temps magnifique. Le petit déjeuner avalé, je fais une toilette des plus sommaires, enfile une tenue légère et les femmes m'éjectent sur le terre-plein où je rejoins les trois autres qui jouent déjà. Elles font les lits, le ménage, elles rangent, elles entassent le linge sale, elles épluchent des légumes et elles parlent sans arrêt. Ca m'énerve parce qu'une seule grande salle à balayer avec un vieux balai de jonc, ça va vite, elles pourraient quand même prendre le temps de venir jouer avec nous ! D'ailleurs "j'aime pas jouer". Je me glisse derrière la maison et regarde l'ancien atelier où Grand-Papa François fabriquait des sabots. Les voisins l'ont transformé en un espèce de débarras fourre-tout ; ils ont conservé la grange et l'étable. L'atelier a disparu depuis longtemps ; c'est vrai qu'il est mort à quatre-vingt- dix ans et qu'il y avait des années qu'il ne fabriquait plus de sabots, le Grand-Pépé. Mémé Caroline nous a tellement parlé de l'atelier et des sabots : dommage, j'aurai aimé voir ça. A propos de Grand-Pépé, les voisins nous ont raconté que plus il devenait vieux moins il dormait la nuit. Alors il se promenait dans les rues du village, martelant le sol de ses sabots. Chacun savait que le vieux Foucher était encore alerte à la cadence où ses pas résonnaient dans l'obscurité. Je rêvasse encore un peu. Soudain j'aperçois la voisine plantée sur le pas de sa porte. Tout en essuyant ses mains sur le devant de son tablier elle me dit d'un air bougon : "Ne reste pas là il fait froid entre ces bâtiments, va jouer devant au soleil". Je pars sans répondre. Je ne sais pas pourquoi elle m'expédie, mais elle ment, il fait si bon à l'ombre. Je rejoins les autres et on s'amuse à se laisser glisser sur les fesses le long du talus. On s'ennuie un peu. Dans les énormes valises apportées par nos mères il n'y a pas de jouets, juste des choses sérieuses, du linge et des habits. Tiens voilà l'Allemand suivi d'un jeune soldat portant une drôle de marmite et un gros pain de quatre livres. Il grimpe notre raidillon et frappe à petits coups sur la porte grande ouverte. Curieux, nous le suivons. Les trois femmes accourent. Nous avons tué le cochon hier, dit-il, voilà un bon bouillon avec du lard. Il fait signe à son aide d'approcher et tend la grande gamelle aux femmes interloquées et réticentes. Je sais, dit-il encore, pas de soupe à midi chez vous, alors pour ce soir. Et il s'en retourne tout content suivi de son second. Tata Zabeth soulève le couvercle. Une agréable odeur se dégage du bouillon encore chaud. J'en voudrais bien tout de suite, je le dis. Grand'Mère réagit avec une violence que personne ne comprend. Eloignez-vous de cette table, dit-elle, les boches ne pensent qu'à une chose, nous empoisonner. Maman et Tata Zabeth protestent et disent poliment mais fermement à Mémé qu'elle se trompe. Mémé explose : Et les gaz asphyxiant, c'était vrai ou je l'invente ? Mais maman, répond Tata, ça, c'est de la soupe ! Soupe ou pas personne ne touchera à cet envoi de l'ennemi. Je n'ai pas envie que les voisins nous trouvent raides morts sur le sol demain matin. Moi je sais ce que c'est "raide mort". A la Maternelle on jouait avec les garçons à "pan t'es mort" ; on se couchait sans bouger sur les gravillons les bras le long du corps. La Maîtresse rouspétait et nous faisait relever. On n'était plus mort. Alors là si on mange de la soupe on va tous être morts pour de vrai ? Mais où jeter ce bouillon ? Les femmes s'interrogent. Pas devant la porte, pas derrière la maison, les voisines sont si commères, pas dans le caniveau, c'est gras et ça se verrait. C'est Tata qui trouve la solution. Elle part laver à la rivière avec un grand balluchon, la marmite dedans. Longtemps après elle revient souriante, la marmite vidée et reluisante. Le pain non plus ne sera pas consommé. Entouré d'un linge il diminuera chaque jour sans que jamais on en mange une miette ; pour moi cela reste toujours un mystère. Quand notre Allemand est revenu le soir tard, Mémé a beaucoup remercié, a rendu la gamelle et a ajouté qu'il restait un peu de bouillon pour le dîner du lendemain. L'Allemand a paru très heureux, il a dit bonsoir et est parti dans sa chambre. Les jours s'écoulent joyeux et ensoleillés ce qui est, paraît-il, tout à fait exceptionnel pour un mois d'Avril dans le Morvan. Nous, les cousins, on ne s'en plaint pas. Nos joues sont moins pâles, plus hâlées et nous mangeons de bon appétit. Me voir avaler sans rechigner le contenu de mon assiette laisse Maman estomaquée : c'est bien la première fois depuis qu'elle est née, dit-elle, pourvu que ça dure ! Nous descendons régulièrement jusqu'à la rivière. Elle a beaucoup grossi ces derniers temps et le courant est très fort. Aujourd'hui les femmes lavent et elles cramponnent sauvagement le linge pour qu'il ne se sauve pas. Mémé regarde l'Yonne et dit : Il a plu fortement sur les Monts, on va y avoir droit d'ici quarante-huit heures. Et se tournant vers nous elle ajoute : Profitez-en bien. Comme si nous attendions son conseil pour jouer, crier, courir, bourrer nos poches de jolis cailloux polis par la rivière et nous chamailler à en perdre le souffle ! Ce soir encore, la dernière cuillerée avalée nous dormirons comme des souches. Demain, ah ! Demain il faudra être en forme pour aller faire des courses à la ville la plus proche. Il fait à peine jour et Maman me secoue avec énergie. J'émerge lentement d'un sommeil profond mais elle me sort du lit et me plante sur mes deux pieds en disant à voix basse : Viens déjeuner. Le sol est froid, j'enfile mes sandalettes et me dirige vers la table sans bien réfléchir à ce que je fais. Je dors encore en dedans ! Ma cousine Pierrette est déjà pomponnée et Mémé attise le feu. Tata Zabeth gardera ses deux plus jeunes et mon petit frère Dédé pendant notre absence. Toujours à moitié endormie, j'avale le café au lait sans prendre de tartine quand une grosse voix rude venant de l'extérieur me fait sursauter. Au mouvement que je fais, le bol que je tiens à deux mains tressaute aussi et du café au lait gicle sur mon joli gilet jaune. Tandis que Mémé va ouvrir la porte au voisin, ma Mère me hurle dessus. Je suis tout à fait réveillée, les autres aussi. J'abandonne le déjeuner. Maman trempe un grand torchon dans le seau d'eau claire et frotte mes habits avec énergie. La gamine qui franchit le seuil est impeccable, humide et gelée. Oh ! Le gros cheval ! Un grand cheval gris avec des taches blanches attend sur la route. Vu de la butte où je suis perchée, il est énorme, ses pattes sont aussi grosses que moi et sûrement beaucoup plus hautes. Je n'ose pas m'approcher. Mais le fermier dit qu'il est vieux, gentil et habitué aux enfants. Moi, je n'ai pas confiance, c'est trop gros ! Les voisins et le fermier sortent une vaste charrette du hangar, lui font dévaler le raidillon en la retenant de toutes leurs forces et attelle le cheval entre les brancards. Je n'avais encore jamais vu cela. Le fermier explique que tous les chevaux ont été réquisitionnés par l'armée française dès la mobilisation et ceux qui restaient, récupérés par les Allemands. Personne n'a voulu de Bijou parce qu'il était tellement vieux, qu'il était bon pour l'abattoir. Maman me traduit en disant que dans le village il ne reste que trois chevaux et que tous les autres sont partis faire La Guerre. Je comprends encore moins. Les Papas et les chevaux sont absents, des Allemands sont ici. Mais c'est quoi La Guerre ? Il me faudra bien un an avant de réaliser ce que veulent dire ces mots-là. D'abord on ne pourra plus faire tout ce qu'on veut, on ne pourra plus acheter quand on veut, autant qu'on veut. On fera des choses bizarres comme peindre en bleu les lumières de dehors. Il y aura les sirènes et il faudra courir se cacher dans les abris. Il y aura surtout les bombardements avec leur bruit effrayant et les murs des maisons qui tremblent. Et aussi l'apparition sur toutes les hauteurs de canons appelés D.C.A. (défense-contre-avions). Longtemps après, la curiosité nous poussera à aller voir la ville de Noisy-le-Sec. Le bombardement avait été tellement violent qu'à Reuil, à soixante kilomètres de là, les vitres avaient volé en éclats. Noisy était sans gare, sans maisons, pleines d'énormes trous, les rails et les trains disloqués. Au fil des mois je comprendrais que ce n'est plus comme avant, comme avant La Guerre, quoi ! Mais pour le moment je suis heureuse, un peu anxieuse cependant quand le fermier me soulève et me dépose doucement sur la banquette de la charrette. Il aide Pierrette puis Mémé et Maman car le marchepieds est très haut. Le fermier prend les rênes, donne un ordre au cheval et la carriole démarre lentement sur les gravillons de la route. Nous sommes un peu remués de droite à gauche, un peu secoués en hauteur. Je ne suis pas tranquille. Plus le temps passe, plus je me détends et je finis même par regarder les talus qui défilent calmement au rythme lent du cheval. Il fait beau. Le soleil monte dans le ciel et Maman m'enfonce mon bob blanc jusqu'aux oreilles pour me protéger. La route monte et le cheval peine. Soudain, du sommet de la colline, on aperçoit la ville en contrebas. Le cheval accélère. Que c'est amusant ! J'aurais aimé que le voyage dure plus longtemps ! Le fermier fait le tour de la place, arrête la carriole non loin d'un bistrot, nous aide à descendre et disparaît. Mémé et Maman nous entraînent vers le marché. Elles remplissent les paniers et les sacs à provisions de légumes, de fruits, de volailles, de lapins. Elles achètent aussi des chaussons chauds pour toute la famille en prévision du froid. Elles voudraient du gros bois pour la cheminée, mais il n'y en a plus. Elles en commandent pour la semaine suivante. Elles jettent un coup d'œil rapide sur les marmites et les tissus et se précipitent vers la carriole. Elles ne veulent pas faire attendre le fermier une minute de plus. Nous patientons mais notre conducteur tarde. Maman dit tout bas à Mémé : Il fait le plein ! Mais quand il arrive, il a les mains vides, il n'a rien acheté. Ca veut dire quoi faire le plein ? Le fermier installe nos provisions, grimpe sur son siège et oublie de nous aider à monter. Nous nous hissons tant bien que mal. Très vite, il sort de la place et fonce sur la route à toute allure. Le cheval ralentit en amorçant la côte qui part de la ville vers le sommet de la colline. L'homme n'est pas de bonne humeur et gronde son cheval. Je vois, il a fait le plein de mauvaise humeur. Il ne desserre pas les dents jusqu'à l'arrivée, dépose nos bagages sur le bas-côté de la route, exécute un demi-tour fou, frôle le talus d'en face et risque de verser. Tata Zabeth nous attend sur le seuil et dit : Il est complètement ivre. J'ai enfin compris : Il a fait le plein... de vin. Les femmes rangent les provisions de la semaine. Maman tire le banc, grimpe dessus, attrape un paquet que lui tend Mémé. Suspendu au plafond par des chaînettes de métal, le garde-manger est une grande boîte carrée ; toutes les bordures sont en bois mais les côtés recouverts d'un petit grillage laissent voir l'intérieur. Maman referme la petite porte en tournant la targette, redescend du banc, se tord un peu la cheville et crie. Mais ce n'est pas grave car elle court dans la maison comme d'habitude. Pierrette et moi devons faire la sieste car nous nous sommes levées de bonne heure. Vers quatre heures Tata nous secoue. Nous allons à la ferme voir si on peut obtenir du fromage et du beurre. Pour le lait il n'y a jamais de problèmes. Quand la fermière aperçoit ces quatre jeunes enfants, timides, poussés par leurs mères, elle "craque" comme on dit maintenant. Elle ne nous laisse pas le temps de regarder le gros coq et les poules qui courent sans arrêt en caquetant et en piquetant le sol. Elle chasse les oies d'un coup de baguette ; elles sont mauvaises, dit la fermière. Elle nous entraîne vers l'étable et donne un verre de lait tout frais trait à chacun... Et vend moyennant beaucoup de billets le beurre et le fromage désirés. Nous avons de la nourriture pour une semaine au moins. Mais où est le pain ? Bon sang, en ville on a oublié de prendre du pain, s'exclame Mémé, il va falloir quémander chez les voisines. Et se tournant vers Maman elle ajoute : Tu ne pouvais pas y penser ! La riposte ne se fait pas attendre : Et toi, t'en as ramené du pain ? Et c'est parti ! Elles se disputent tout le temps ces deux-là ! (Inachevé 20/11/97) Brusquement, au cœur de la nuit, un tintamarre épouvantable nous réveille. La pluie, la pluie de printemps, vient de s'installer pour plusieurs jours. Mémé nous l'avait dit mais on ne l'avait pas cru. Comme la maison n'a pas servi depuis plus d'un an et que Grand-Pépé François à quatre-vingt-dix ans se désintéressait de ces choses-là, Mémé se lève une lampe à la main et inspecte murs, plafond, portes et fenêtres. La maison tient bon, dit-elle. Assise, le gros édredon serré contre mon cou, je regarde les ombres amusantes que la lampe-pigeon dessine au fur et à mesure que Mémé se déplace. C'est une petite lampe à pétrole : le réservoir est en cuivre muni d'une poignée. Une mèche de coton plonge dans le réservoir et peut monter ou descendre à l'aide d'une petite roue crantée, selon que tu veux beaucoup ou peu d'éclairage. Un verre rond entoure la mèche et renvoie la lumière. Soudain, on frappe à la porte et on voit apparaître "Riquet à la houppe", tu sais dans le livre d'images, celui qui a ses cheveux dressés comme une crête de coq. Je m'enfouis sous l'édredon pour rire aux éclats. L'Allemand, en tenue de nuit, une veste sur les épaules, très courtois vient demander si nous avons besoin d'aide. Nous avons tellement l'habitude de le voir impeccable ! Grand-Mère répond sèchement" tout va bien merci ". Et chacun repart se coucher et terminer sa nuit. Au matin, le jour ne se lève pas. La pluie, le brouillard enveloppent tout. On devine le terre-plein devant la maison, mais on ne distingue pas la route. Il va falloir s'occuper jusqu'à l'heure du coucher, ce n'est pas drôle, et en plus il fait froid. Pierrette et moi apprenons à faire du point de croix sur de petits morceaux de tissu. Avec une grosse aiguille et du fil rouge, nous nous efforçons de broder nos initiales. Ma cousine aime bien cette activité, mais je trouve cela long et ennuyeux. Nous n'avons pas de crayons de couleurs mais de multiples crayons à papier et de petits carnets traînent au fond d'un tiroir. Nicole et Dédé gribouillent, je veux dire dessinent sur des morceaux de carton. La maison est calme, tranquille car ici il n'y a même pas de T.S.F.(téléphonie sans fil autrement dit radio). De temps à autre le bébé Jean-Pierre pleure, c'est l'heure de la tété. Cela nous donne un prétexte pour bouger et regarder comment cela se passe. Nicole réclame de téter aussi, mais Tata Zabeth refuse et la petite fille est triste. Dans cette atmosphère douce et feutrée, la voix de Maman nous fait sursauter. Elle tient son lourd Dédé à bouts de bras et nous le montre : éclats de rire général. Dédé a des moustaches violettes, des pommettes violettes, des mains zébrées de violet. Tout en dessinant le bon gros gamin a léché le crayon. Cette mine de crayon mouillée fait de l'encre violette et des désastres familiaux. La pluie incessante tambourine toujours, et nous sommes obligés d'allumer le plafonnier. En effet, bien qu'il y ait l'électricité au village, une grande lampe à pétrole séjourne en permanence sur la table à cause de nombreuses coupures de courant aussi soudaines qu'imprévues. L'abat-jour du plafonnier est très amusant. Il est en verre blanc, je veux dire peint en blanc, pas transparent, il fait comme une assiette renversée qui a de la dentelle autour. Ah ! J'ai trouvé, cet abat-jour est blanc mais brillant. Il brille comme mon joli collier de nacre que je porte autour du cou. Et surtout, le grand fil peut monter et descendre en passant dans une sorte d'œuf. Si j'avais le droit de grimper sur la table, j'attraperais le bout du fil et je jouerais bien à ça toute la journée. Et il pleut, il pleut sans arrêt et, comme dit ma Tante, me voyant si désœuvrée, "celle-là elle ne sait pas quoi faire de sa peau". Je regarde ma peau et je me dis que c'est tout moi qui ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, je suis triste et vais regarder les étincelles qui jaillissent des bûches humides. Je suis réveillée par mon propre ronflement : ce n'est pas de ma faute, il paraît que j'ai des végétations. Et cette pluie violente, incessante, glaciale dure huit jours sans discontinuer, jour et nuit. Les trois femmes sortent à tour de rôle pour les tâches indispensables. Nous, les quatre cousins restons à l'intérieur, accumulant les bêtises. Nous courons dans la maison, nous jouons à cache-cache en se fourrant sous l'édredon, d'où on se fait déloger avec une bonne fessée. Cela ne nous empêche pas de recommencer. On s'introduit aussi dans le cagibi, la réserve de nourriture. Je me glisse sous la table et Pierrette qui me court après s'attrape le coin de la table en plein front. Mémé lui passe de l'arnica mais ma cousine garde un magnifique œuf de cane entre les deux yeux. Malgré ses trois ans et demi, Nicole découpe avec minutie de petits bouts de papier qu'elle enfile dans une vieille enveloppe jaunie. Dédé caresse avec tendresse le chat tigré de la voisine. Les femmes jettent cet intrus à l'extérieur mais il revient toujours. Alors puisqu'il n'est pas agressif, elles abandonnent la partie. Mon petit frère passe des heures avec cette bestiole, lui parle doucement, le câline. Toute son enfance Dédé sera l'ami des animaux et le restera étant adulte. On s'ennuie... Et puis, une après-midi, on a soudain l'impression qu'il fait jour. La pluie se calme. Nous restons plantés sur le pas de la porte car nous ne sommes pas chaussés pour attaquer le sol détrempé. Au prochain marché je rapporte une série de bottes, dit Maman. En petites sandalettes, nous sommes quand même autorisés à faire un pas à l'extérieur pour contempler le magnifique arc-en-ciel. Il est juste vers le trou de la rivière, tout rond et rempli de belles couleurs. Nous respirons fort, l'air sent si bon dehors, nous sommes lassés de la cheminée et de sa fumée. Maman, je voudrais dessiner un arc-en-ciel, tu me rapporteras des crayons de couleurs ? Promis, me répond Maman. Des crayons, des bottes et... du pain. Elle regarde Mémé droit dans les yeux. Elle lui en veut encore, quinze jours après leur oubli. Dans trois jours j'aurai des bottes. C'est interminable trois jours, le sol est trempé mais le ciel est tout ressuyé. Cette attente est pire que l'obligation de rester à l'intérieur quand il pleut. J'aime un peu moins la Maison du Morvan aujourd'hui, mais je l'aime encore bien sûr. Une explosion de joie salue l'arrivée de la charrette tirée par le cheval blanc tacheté de gris. Le fermier est détendu. Il aide Maman à grimper à côté de lui. Vivement qu'ils reviennent. La matinée passe, mais ils ne reviennent toujours pas. Cela fait dix fois, quinze fois que je me glisse sur le seuil espérant entendre le grincement de la charrette et le martèlement des sabots du cheval. Un chien aboie, un coq chante, mais de fermier point. Exaspérée j'interroge Tata : Mais qu'est-ce qu'ils font ? Dis-donc, c'est toi qui charge le bois ? Répond Grand-Mère à qui je n'ai rien demandé. Les voilà, les voilà, crie soudain Pierrette. Ca c'est trop fort, depuis le temps que je guette, j'ai loupé l'arrivée. La charrette est pleine à craquer. Maman ne descend pas tout de suite Elle a des sacs entre les jambes et sur les genoux. Le fermier la débarrasse avant qu'elle ne puisse s'extirper de là. Toute la partie arrière de la charrette regorge de bûches de toutes tailles. Le fermier et les trois femmes attaquent le travail. Il faut vider la charrette, grimper le raidillon, déposer les bûches bien en ordre devant la maison, redescendre et recommencer. Ca dure, ça dure une éternité. Maman s'arrête de décharger un moment et fouille dans le grand cabas. Radieuse elle me tend une magnifique boîte de crayons de couleurs. Je fais une tête sinistre et dis à peine merci. Maman s'étonne, ne comprend pas. C'est bien ça que tu voulais ? Alors je hurle : j'veux pas de crayons, j'veux des bottes, j'veux sortir. Jamais contente, dit Maman en me giflant à toute volée. Je me réfugie dans le cagibi pour pleurer : "J'ai plus besoin de bottes, voilà" et en disant cela je pleure de plus belle. Tandis que mon chagrin s'écoule entre les murs étroits du placard, Maman distribue à chacun un gentil cadeau. Pierrette a les mêmes crayons que moi, Nicole et Dédé deux énormes crayons rouge et bleu. Maman a aussi rapporté des albums à colorier et des crayons à papier pour tous. Je sors de mon refuge. Maman tend un minuscule hochet à Bébé Jean-Pierre mais Tata Zabeth dit qu'il vaut mieux le savonner avant de le donner à l'enfant. Maman proteste et fait remarquer qu'il est soigneusement emballé. Rien n'y fait. Tata frotte avec vigueur le petit objet puis rassurée le donne à son fils. Alors j'aperçois devant la fenêtre une rangée de bottes en caoutchouc, rouges et bleues, brillantes, superbes. Je fais semblant de ne pas les voir, je les ignore, je suis trop vexée de la gifle que j'ai reçue. Et quand les femmes décident que les gosses doivent prendre l'air en attendant le repas de midi, je dis que j'ai froid et je me loge près de la cheminée. Elle est franchement impossible, dit Maman. Et moi je pense qu'elle ne comprend rien. Et je reste muette, moi que mon Grand-Père appelle ma petite pie chérie. Tiens je voudrais bien le voir Pépé. Il me manque. Et puis je n'y tiens plus. Attirée par les cris de joie des trois autres gamins qui se défoulent de onze jours de séquestration, je fonce tête baissée ramasser les bottes restantes. Je me redresse. Vlan ! Je me prends le coin de la fenêtre en plein milieu du crâne. Je n'ai pas trop mal, mais je hurle à la vue du sang qui m'aveugle. Mémé attirée par mes cris, rentre en trombe dans la maison, m'attrape sous son bras comme un balluchon, me penche sur la cuvette, rince avec un gant de toilette et dit : ne braille pas comme cela, c'est juste une petite coupure. Elle m'assoit sur le banc et ajoute : reste tranquille dans cinq minutes il n'y paraîtra plus. Et elle repart à la corvée de bois. J'attends en regardant le balancier de la pendule, saute du banc, jette le gant de toilette dans la cuvette rougie et fonce rejoindre la famille. Je suis heureuse... Nous courons, nous rions, nous poussons des cris de joie, au grand étonnement des voisins. Il faut dire que des vrais gamins, il n'y en a plus beaucoup au village. Il y a des vieilles personnes de cinquante ans comme ma grand'mère ou de très jeunes mamans qui ressemblent plutôt à de grandes sœurs. Les quelques gosses qui ont notre âge sont sérieux, aident leurs parents, sont utiles et ne jouent pas. En tout cas c'est formidable d'être dehors et de se dépenser. Cela nous donne une faim de loup. J'ai pourtant l'impression que les femmes sont tout le temps en train de faire à manger tandis que nous attendons que cela vienne. C'est une sensation nouvelle pour moi d'avoir faim et d'être contente de venir à table. L'après-midi passe vite, et de nouveau nous devons aller à la ferme pour le ravitaillement. La fermière est de plus en plus gentille. Aujourd'hui elle nous entraîne vers l'étable. Bon, si c'est pour voir son fils qui sort la paille qui empeste avec sa fourche, j'aime mieux ne pas entrer. Je laisse la famille traverser la cour et fais semblant de regarder ailleurs. Ma mère qui voit tout, m'attrape par un "abattis", je veux dire par un bras et me force à avancer. Nous voici dans l'étable obscure. Nous faisons très attention où nous mettons les pieds. Soudain la fermière soulève Dédé et lui montre quelque chose. Je veux voir aussi. J'en oublie le caniveau et son odeur et je me précipite coller mon nez entre les lattes de bois. D'abord je ne vois pas grand chose. Puis j'aperçois une vache, une très grosse vache. Et, couché sur la paille, un petit veau à longues pattes, né cette nuit. Il se soulève péniblement, avance en titubant. La vache de son mufle le pousse doucement vers ses mamelles. Il s'y accroche et tête goulûment. C'est le bébé Jean-Pierre de la vache. Et puis il s'affaisse, épuisé d'avoir tant bu. Je reste pour voir s'il va encore se passer quelque chose. Maman me tape gentiment sur l'épaule et dit : Pour quelqu'un qui ne voulait pas entrer, tu ne veux pas ressortir, je suppose. Je pense : Si elle continue, je vais la "bouffer" et je me précipite dans la lumière sans rien dire. Est-ce possible que Maman ait été un jour une petite fille ? Est-ce que Mémé Caroline a vraiment été une gamine ? Est-ce qu'elles n'ont jamais pensé ou réfléchi sans l'aide des grandes personnes ? Est-ce qu'elles étaient toujours d'accord avec ce qu'on leur disait de faire, sans réagir, sans se rebeller ? Connaissant leurs caractères à toutes deux, j'en doute. Alors, elles ont tout oublié ! Et bien moi quand je serai grande, il faudra que je fasse bien attention avec ma fille. Je marche en fixant le bout de mes sandalettes bleu-marine. Tiens, nous sommes déjà arrivés devant la maison ! La voix de Maman me fait sursauter : Tu es plus bavarde d'ordinaire. Si elle savait ce que je pense. Et la petite pie chérie de Grand-père Arthur répond sans rougir : Je pensais au petit veau. Au fait, la fermière a dit : Le petit veau de La Roussette. Voilà le nom le plus idiot que je n'ai jamais entendu, car dans ce village toutes les vaches sont des roussettes. Il n'y a pas une vache blanche, pas une noire, pas une à deux couleurs. Enfin ! Les jours passent. Il fait beau et l'on s'ennuie un peu. Un soir après le dîner, les femmes mettent un grand chaudron dans la cheminée. Mais puisqu'on a mangé, qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces œufs ? Je regarde les bulles qui se glissent entre les coquilles. Mémé me dit : attention tu es trop près du feu. Je recule un peu puis j'abandonne les bulles, c'est trop long d'attendre. Le lendemain matin les femmes emballent les œufs dans de vieux torchons. Des "cannettes" de bière remplies d'eau fraîche sont déjà dans le panier. Une cannette, c'est une petite bouteille avec un bouchon en porcelaine qui serre très fort sur le goulot par un ressort en fer. La surprise c'est que l'on part tous en pique-nique dans la petite forêt à quelques kilomètres du village. Jean-Pierre est installé dans un vieux landau prêté par une voisine et en avant pour la promenade. Cette petite route est à nous, complètement à nous. Pas un villageois, pas un Allemand, tous envolés, tous disparus. Nous sommes devant nos mères à courir et à gambader. Quand même, il commence à faire chaud et nous recherchons l'ombre. Nous ralentissons et finissons par être à la traîne derrière nos mères. Grand'mère marche d'un bon pas, toujours le même, et se retrouve bientôt seule en tête. Elle s'arrête, prend Nicole d'une main et Dédé de l'autre et les entraîne. Maman porte le gros panier. Tata Zabeth a les plus grandes difficultés avec le vieux landau. La roue avant droite n'a pas de capuchon, elle gigote sur son axe, fait éjecter le bout de ficelle qui doit la maintenir et s'échappe. Arrêt pour réparation sommaire : nouveau bout de ficelle, en espérant que ça tienne quelque temps. Après deux nouvelles réparations et une nouvelle courbe de la route, nous apercevons enfin le petit bois. Du même coup, nous entendons des voix rauques, des coups de sifflets, des bruits de machines, des craquements d'arbres qui s'affaissent. Nous pensons d'abord à des bûcherons. Mais plus on s'approche, plus ces voix sont hargneuses, terribles, scandées ; ce sont des sons rauques, des ordres en allemand, incisifs et coupants. Nous sommes figés sur le bas-côté de la route. Nous venons de prendre contact avec l'ennemi tel que Mémé nous l'avait décrit. Un gradé à casquette débouche soudain dans notre espace et nous hurle en allemand : Interdit, interdit. Et nous fait signe de faire demi- tour. Bouleversés, fatigués, nous rebroussons chemin. On se traîne assez loin pour ne plus rien voir ni rien n'entendre et on s'affale à l'ombre, sur l'herbe du talus. Les œufs durs ne nous semblent pas trop bourratifs, le jambon de pays non plus. Maman sort des verres et distribue l'eau fraîche. Nous boudons le fromage et les pommes. Allongée sur le dos, je regarde les petites feuilles s'agiter puis perds la notion du temps ; je crois bien que j'aie dû m'assoupir. Longtemps après nous regagnons la maison, drôle de pique-nique. Quand nous sommes tous rentrés, Mémé referme la porte avec énergie. Mais, pourquoi ? Il fait si beau ! Alors à voix basses les trois femmes laissent exploser leur colère : "Les voisines, la fermière, le maire, tout le monde savait que les Allemands installaient du matériel de guerre sur les terrains de la commune et personne ne nous a rien dit. Celle qui nous a prêté le landau savait où nous allions et nous a laissé faire avec nos cinq gosses". Grand'mère que je n'ai jamais vu pleurer, va fondre en larmes, c'est sûr. Elle se reprend et dit d'une voix éteinte : "Je me croyais encore une fille du pays"... Puis se tournant vers Tata Zabeth et reprenant toute son assurance : "Dis, tu le changes quand ton gosse ?" N'empêche qu'à partir de ce jour nous n'avons plus rien emprunté aux voisines et juste un bonjour du bout des lèvres. Maintenant nos promenades partent à l'opposé du bois, nous allons vers les champs et les cultures, nous ramenons d'énormes bouquets de marguerites que nous déposons dans les seaux à eau car nous n'avons pas trouvé de vase. Il y a bien de grands bocaux pour les conserves, mais c'est nettement trop petit. Que la maison est jolie avec toutes ces fleurs ! Nous sommes si heureux dans cette maison. On manque un peu de jouets, mais au fil des semaines Maman ramène du marché un minuscule ballon en caoutchouc multicolore, une corde à sauter, deux petites voitures, des découpages, des perles et surtout du papier pour dessiner. Cette semaine elle a réussi à persuader le marchand de couleurs de lui vendre une grande feuille de papier Krafft alors qu'il s'y refusait obstinément. Rentrée à la maison, elle a taillé cette feuille en carrés à l'aide du couteau à découper le jambon, a distribué un morceau à chacun, et a dit de ne pas gâcher car elle n'est pas sûre d'en obtenir la semaine prochaine. Nous les grandes de plus de cinq ans, on comprend. Nicole espère une poupée mais Maman n'en a pas encore trouvé. Il fait de plus en plus chaud et les femmes ont décidé que nous irions faire trempette dans l'Yonne cet après-midi. Nous emporterons aussi le goûter. Nous devenons de plus en plus hardis et nous descendons le raidillon avec de plus en plus d'assurance. On joue, on court, on crie, on se trempe un doigt de pied parce qu'on est venu pour ça, on se sauve en hurlant parce que l'eau est glaciale, on se laisse tomber sur les serviettes de toilette et on dévore les tartines de compote. La remontée est toujours aussi difficile. De la route nous apercevons la voisine qui s'agite devant notre maison. "Qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là ?"dit grand'mère. Nous nous précipitons. Elle crie en agitant la main " Caroline, une lettre de votre mari !"Quel culot, dit Grand'mère, elle a même regardé d'où elle vient !" Grand'mère pénètre dans la maison avant d'ouvrir soigneusement l'enveloppe avec un couteau. Nous nous agglutinons à elle comme les mouches sur le papier collant pendu au plafond par une punaise. "Votre grand-père arrive" dit-elle. Maman file à toute allure à la ferme pour acheter un gros lapin ou un vieux coq ou des poulets, ce que la fermière voudra bien céder. Elle tarde à venir et cela nous inquiète un peu. Finalement elle revient triomphante avec un panier de jardin : un lapin recouvert d'un torchon propre y trône sur un grand plat. Dans un bol, en équilibre, le sang du lapin mélangé à du vinaigre. Il y a aussi la carcasse, les abats, les ailerons d'une dinde pour faire un ragoût. C'est la fête. Toute la journée Grand'Mère s'agite, bougonne. De temps à autre elle murmure : J'vais lui dire, j'vais lui dire. Grand'Mère qui parle toute seule comme les vieilles décrépites du village, cela me chagrine. Et puis, elle va dire quoi et à qui ? Chaque soir quand l'Allemand arrive en disant : Bonsoir Mesdames, Grand'Mère fait semblant de ne pas le voir. Mais ce soir, la voilà qui se précipite dès qu'elle entend ses pas, sort la lettre de la poche de son tablier, se hausse sur la pointe des pieds et tenant la lettre à bout de bras, la fourre sous le nez de notre hôte forcé. Il est tellement plus grand qu'elle ! Elle crie presque "Mon Mari arrive ! Mon Mari arrive !" Lui, imperturbable, fait un signe de tête et dit "Compliments, Madame". Et il disparaît dans sa chambre. J'ai à peine le temps de penser : en voilà une curieuse façon de parler, que Grand'Mère se déchaîne, furieuse. "On ne va pas s'entasser comme des lapins tandis que l'Autre va se prélasser dans la grande chambre". Maman et Tata Zabeth se ruent sur Mémé pour lui imposer silence. "Tu vas nous faire avoir des ennuis avec tes hurlements" dit l'une. "Ca s'est bien passé jusqu'à présent, dit l'autre, il faut que cela continue." Grand'Mère éclate de nouveau, mais soudain l'Allemand réapparaît, toujours impeccable dans son costume civil. Nous sommes muets, mais lui, se tenant respectueusement devant Mémé dit d'une voix ferme : "Ne craignez rien, Madame, dès demain matin je prendrais mes dispositions pour que l'Etat-Major me trouve un autre logement. Bonsoir". Cette fois Grand'Mère s'avoue vaincue, et pas par les armes. La joie éclate, les femmes s'embrassent. Mais moi je me demande ce que l'Allemand va emporter. Il a dit : mes dis-po-si-tions. Je ne lâche pas Maman tant qu'elle ne m'a pas expliqué ce mot. Elle me rabroue en disant : "Il va partir et il n'emportera rien de notre maison." Alors, je suis contente moi aussi. Le lendemain matin le soldat dit : "J'envoie mon ordonnance chercher mes affaires, il emportera également les draps et vous les rapportera dès que possible. Adieu." Je suis triste de le voir partir, je m'étais habituée à sa présence, mais je ne le dis pas à cause des grandes personnes. A peine l'Occupant sorti, Mémé pénètre dans la chambre et nettoie rageusement comme s'il avait attrapé la rougeole. En fin de matinée, l'ordonnance arrive et fait disparaître toute trace de son supérieur. Mémé prépare de l'encaustique avec de la cire et une sorte d'essence. Elle astique les meubles et les fait reluire. En quelques instants plus de poussière non plus sur le sol dallé. Elle refait le lit, aplatit l'édredon avec le manche à balai et satisfaite, ressort. Vite, Pépé, arrive ! Vu le temps que la lettre a mis, Pépé débarque deux jours plus tard, un peu poussiéreux mais toujours aussi vif et gai. J'aime sa moustache grise en guidon de vélo de course et je réclame une double ration de bisous. Je l'adore mon Grand-père. Pépé dit avec un air malicieux : "La maison de Jouarre est nette, je n'ai rien laissé traîner ; enfin, c'est presque aussi bien que votre rangement, mesdames". Et il rit Pépé, heureux de nous avoir retrouvés, heureux de nous taquiner. Pour nous c'est la joie. Dès le lendemain, il creuse une rainure au milieu du terre-plein, ce qui met les femmes en fureur. "Voilà une source d'eau stagnante, de chutes, de plaies et de pleurs" dit Grand'mère exaspérée. "Vous allez voir ce que vous allez voir" répond Pépé. Il examine attentivement le tas de bois, prend la plus grosse bûche qu'il peut trouver et la roule dans la rainure. Il plante quelques morceaux de bois autour de la bûche, vérifie qu'elle ne bouge plus et file derrière la maison. Il bavarde longtemps avec les voisins et revient avec une longue planche bien lisse qu'il pose en travers de la bûche. Il fait semblant de s'asseoir à l'extrémité de la planche et dit "qui grimpe à l'autre bout ?" "Moi" répondent quatre voix. Il nous installe et retourne à l'autre bout. C'est la plus merveilleuse balançoire qui existe ! Personne n'a idée de descendre. Mais soudain Pépé arrête le jeu, regarde sa montre et dit "A table". Il se dirige vers la salle mais on entend la voix de Mémé qui l'apostrophe vertement : "Ce n'est pas près d'être cuit, tu crois que c'est facile de faire un civet dans une cheminée, ou ça brûle ou ça ne cuit pas, et tu sais bien que cette sauce ne doit pas bouillir. Il a fallu faire cuire les pommes de terre à l'eau d'abord. Tu te crois encore à la maison." Pépé est sidéré, jamais au grand jamais Mémé n'a élevé la voix quant à l'heure des repas. Depuis leur mariage, il y a très longtemps, ils sont passés à table à midi juste et à sept heures tapantes. Deux années plus tard Pépé racontera à Tonton Pierre que cela ne vaut rien de donner trop de liberté aux femmes, qu'elles n'en font qu'à leur tête, et qu'elles ne respectent même plus l'heure des repas. Il n'a jamais digéré ce merveilleux civet avalé à deux heures de l'après-midi. Et pourtant c'était si bon : Mémé m'a donné mon morceau préféré, l'omoplate, avec trois petites pommes de terre rondes et cette sauce brune si parfumée, un délice ! Le plus dur ça été de finir le pain resté à côté de mon assiette. Maman sans rien dire a versé un peu de sauce dans mon assiette et j'ai fini le pain. Ouf ! Plus faim ! Des heurts, il y en aura souvent. Depuis quelques mois les trois femmes se sont organisées. Avant l'arrivée de Pépé, elles se chipouillaient entre elles mais jamais très gravement. Maintenant on sent que le feu couve. Pépé veut retrouver son autorité à part entière, les femmes font front commun. Pépé est saisi de voir que ses filles ne lui obéissent plus, qu'elles osent émettre des opinions contraires à ses dires. A l'abri des oreilles et des regards indiscrets, la maison en entend, des voix coléreuses. Nous restons dehors loin des grandes personnes qui se disputent. Dommage on les aime tous ! (Inachevé le 08-04-98 et repris le 20-10-99) Le printemps s'écoule lentement, sans fait notable. Le soleil qui réapparaît entre deux violentes ondées, sèche l'herbe des talus. Nos petites bottes s'agitent et s'enhardissent à traverser la rue. Un jour Pierrette et moi décidons d'aller seules à la ferme. On joue puis on s'éclipse. On file, on file le plus vite possible. La ferme est en vue. C'est merveilleux ! Soudain des éclats de voix et des pas précipités nous arrêtent dans notre élan. Mémé et Maman nous rattrapent et d'un même élan nous saisissent par un bras, nous faisant faire demi-tour comme une toupie. Elles nous font courir jusqu'à la maison et referment la porte avec énergie. La raclée que nous avons reçue ! Nos fesses nous en ont brûlé jusqu'au lendemain matin. De leurs cris qui scandaient leurs coups je n'ai retenu que " Les Boches, la Guerre, le Danger, pas de Cervelle". Quand on n'a pas six ans et qu'on veut aller voir les poules, est-ce qu'on pense à toutes ces choses-là ! Et tout doucement arrive l'été. Et avec lui un soleil ardent, dense, insupportable qui vous tombe sur la tête dès que l'on franchit le seuil. La lumière est trop vive, la chaleur étouffante, du réveil au coucher. Nous nous calfeutrons dans la fraîcheur de la maison. La porte de bois reste fermée et quand nous l'ouvrons par nécessité une bouffée d'air brûlant s'engouffre. Il y a toujours une main pour repousser rapidement le battant derrière l'individu sortant. Les volets mi-clos laissent passer juste assez de lumière pour s'occuper sans difficulté. Oui, mais à quoi s'occuper sinon à "faire l'andouille" comme dit ma Grand'mère. Nous accumulons les bêtises, forcément. Nous sommes trop nombreux dans une seule pièce. Et l'on entend : "Ote-toi de mes jambes tu vas me faire tomber avec le bébé, garez-vous la marmite est brûlante, groupez-moi ces crayons de couleur que j'aie une place pour éplucher les légumes." Les grandes personnes sont incroyables ! La table est immense, elle n'a qu'à se mettre à l'autre bout puisque j'étais-là la première. Ma mère veut que je me réduise en Petit Poucet ou quoi ? Il faudrait savoir, en général elle se plaint qu'à bientôt six ans j'en parais quatre et aujourd'hui je la gêne partout où je me trouve dirige. Je ne dis rien, je ramasse mon "bazar", me glisse sous la table, bien au milieu pour ne gêner les pieds de personne. J'explose de colère silencieuse en gribouillant rageusement une page de mon album à colorier. Et quand on veut jouer à chat en courant partout, on nous assoit de force sur le banc. Cinq minutes de tranquillité, annonce Mémé. Mais après, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? J'en ai assez du dessin, des perles et du point de croix. Ah ! Si seulement je savais lire. Je reconnais déjà les lettres et certains mots. "Maman, Maman, apprends-moi à lire !". Réplique de ma Mère qui détache chaque mot : "apprends-moi à lire, s'il te plaît". Et c'est ainsi que j'ai commencé l'apprentissage de la lecture par une après-midi torride d'été dans le Morvan. C'était facile, mais facile... et j'étais si heureuse. Maman a toujours prétendu que je savais pratiquement lire à force de jouer avec le gros dictionnaire rose. Ce qui est sûr c'est que de retour à Villemomble je lisais couramment et pouvais affronter la Onzième (C.P.) en avance sur les autres. Bon, en voilà au moins une de calmée, souffle Maman à sa sœur. Je fais semblant de n'avoir pas entendu et fixe le livre d'images qui s'étale devant moi. Pierrette est plus accommodante que moi et ne paraît pas souffrir des remontrances permanentes, mais après tout je n'en sais rien. Les petits, assis par terre dans un coin, jouent avec des cubes en bois un peu défraîchis que Maman a trouvé au Fourre-tout du marché. Ils sont vraiment très sages et composent les différentes images avec l'aide occasionnelle de Tata. Le calme semble s'installer dans la maison. Seul le bruit du marteau résonne de temps à autre : Pépé fait quelques réparations provisoires mais urgentes. Il fait de plus en plus chaud et nous buvons beaucoup d'eau fraîche. Soudain, des grondements sourds, des roulements s'enflent puis s'atténuent, suivis par d'autres grondements plus sonores encore et par des roulements assourdissants. Il fait de plus en plus sombre. Mémé, si économe, ferme complètement les volets et allume la lampe à pétrole. Chacun arrête toute activité et s'étonne. La lumière en pleine journée ! Curieux ! Elle clôt aussi les fenêtres et nous rassemble autour de la table. Soudain un craquement violent fait vibrer la maison, suivi immédiatement d'un éclair qui filtre à travers les interstices des volets. Nous sursautons, effrayés. Le vacarme et les éclairs se succèdent. Le tumulte augmente encore quand la pluie sauvage se met à marteler la toiture. Rien de tel pour nous rendre sages et dociles. Seul, le Bébé Jean-Pierre, réveillé en sursaut hurle à pleins poumons. Tata le prend et le fait téter... A peine le rôt fait, il se rendort dans les bras de sa maman. Nous sommes figés, terrorisés. Je regarde Maman, mais elle n'a pas l'air rassurée non plus. Dédé, debout, s'est réfugié dans ses jupes et a posé la tête sur ses genoux. Pépé s'assoit près de la cheminée et regarde les cendres encore rougeoyantes du repas de midi. Mémé qui à l'ordinaire fait semblant d'obéir à Pépé tout en faisant rigoureusement ce qu'elle veut, apostrophe son mari : "Arthur ne reste pas près de ce conduit et vient avec nous". Et Pépé docile se glisse sur le banc en bout de table. Bien que morte de frousse, je suis sidérée. Il faut dire que sa Caroline lui a maintes fois conté la foudre qui tombe et qui tue. D'un geste du menton, elle me fait signe et désigne le vieux bouquet de buis poussiéreux suspendu au-dessus de la porte. Elle dit : "Tu comprends ? " Et moi, suppliante, j'implore : "Mémé, s'il te plaît, jette un rameau dans la cheminée". L'orage dure et s'éternise et se prolonge encore. Il est là, juste au-dessus de nous, il est sur le clocher, sur le village tout entier, sur la rivière. Il nous enveloppe. Les éclairs succèdent aux éclairs. Le tonnerre gronde et roule sans discontinuer. L'après-midi s'écoule et nul ne bouge, figé sur place. Personne ne songe à préparer le dîner. D'ailleurs, qui pourrait avaler quelque chose ? Je n'ose à peine avaler ma salive tant je suis terrorisée. Soudain, la petite voix étouffée de Dédé murmure "Vite, Maman, pipi" Maman relève le gamin toujours couché sur ses genoux, le met debout et les voilà qui courent vers le seau hygiénique réservé pour la nuit. Trop tard ! Pépé regarde la pendule indiquant sept heures, mais ne dit rien. Mémé se décide à bouger, met quelques brindilles dans la cheminée, ajoute trois bûchettes et se tournant vers nous déclare : "Ce soir, soupe au lait froide et sucrée, omelette aux fines herbes, fromages. J'aime bien cette soupe-là ; tu glisses de petits bouts de pain dur dans le liquide, tu laisses ramollir, c'est délicieux. Il fait nuit noire quand enfin l'orage s'éloigne. Nous avalons tout goulûment et nous allons nous coucher, épuisés, laissant les adultes bavarder. La porte et les volets grand'ouverts laissent pénétrer un soleil doux et joyeux. L'air exhale une bonne odeur d'herbe humide qui achève de sécher. Je bondis de joie dès le réveil. Comment un tel changement de temps est-il possible ? Le petit déjeuner est vite expédié. A nouveau le terre-plein, martelé de nos cavalcades, retrouve nos cris de sauvages déchaînés. Seules les planches de la balançoire gorgées d'eau rappellent le déluge de la veille. Ce temps agréable dure quelques jours. Progressivement la température augmente et devient à nouveau insupportable. A peine une semaine s'est-elle écoulée qu'un nouvel orage nous tombe dessus en fin de matinée, sans prévenir, sec, violent, effrayant. Il ne s'estompera qu'au milieu de la nuit... à moins que je me sois endormie avant qu'il ne s'éloigne ! Tout le mois est terrible. Nous ne descendons plus à la rivière, nous restons enfermés. C'est intenable. Depuis plusieurs jours déjà les grandes personnes discutent mais ne sont pas du même avis : rester ? Retourner à Jouarre ? De toutes façons les Allemands sont partout, alors... Et puis ce matin, elles se mettent d'accord : autant repartir. Partir, ah non ! Je file dehors malgré la température excessive. Je me cache à l'ombre, je pleure à gros sanglots sans pouvoir me retenir. Je suis malade de chagrin. Je ne veux pas la quitter cette maison, je l'aime moi, cette maison. Si je pars, je sais que je ne la reverrai jamais. Je suis inconsolable. Au bout d'un temps infini je me décide à rentrer, mais les adultes préoccupés discutent encore : maintenant que les "Boches " sont partout, y a-t-il encore des moyens de transport ? se demande Mémé. Je refuse de voyager avec mes trois gamins dans les conditions atroces de l'aller, dit Tata. Renseignons-nous, dit Maman. Je m'en charge, conclut Pépé. Pendant une bonne semaine, il va aux nouvelles, part en ville avec le fermier, rentre même au bistrot discuter avec les gens. Quelques longues journées s'écoulent encore. Aujourd'hui, l'heure du dîner est passée depuis longtemps, les femmes ont fini par nous faire manger, mais Pépé n'est toujours pas revenu. La nuit est tombée quand il arrive enfin. "Ca va, dit-il, nous pouvons attraper un train omnibus dimanche soir." Il est content, Pépé. Content de lui, oui, mais je le connais bien, il est surtout heureux de retrouver son jardin, son grand tablier bleu, son chapeau et sa bêche. A table, dit-il de bonne humeur. Les femmes nous mettent au lit avec un bisou distrait et rejoignent Pépé qui est déjà assis et qui attend que le dîner soit servi. Et ils parlent, ils parlent si fort que je ne peux pas dormir. De toute façon je ne veux pas dormir puisque je veux tout savoir. En fait, je ne saurai rien du tout car je m'endors immédiatement. Je suis réveillée par la voix de Maman. J'entends : "Nous sommes mardi, nous avons cinq jours pour tout préparer, c'est amplement suffisant." On nous octroie un coin bien délimité. Nos jouets y sont déjà. Cela me fait penser à la cour de la ferme. Quand les poussins naissent, la fermière pose dans la cour un grand grillage rond, puis elle installe la poule et ses petits. Bon ! Nous ne sommes pas derrière une clôture, bien sûr. N'empêche que nous sommes parqués... Et la première chose qu'on a envie de faire c'est de sortir des limites. C'est bien plus drôle de désobéir, sans être vu, que de rester docilement dans notre coin. Un nouveau jeu dont on ne se prive pas et qui nous vaut de temps à autre un énergique rappel à l'ordre. On fait semblant d'obéir au moins cinq bonnes minutes... Et on recommence. Maintenant, les femmes s'affairent tellement qu'elles finissent par ne plus jeter un œil sur nous. Du coup on se met à jouer, pour de vrai. Elles posent tous nos vêtements sur la table, font des tas, les défont. Elles mettent en bout de table toutes les affaires usagées ou trop petites. Ils ont tellement grandi et forci en quelques mois, dit Tata, je ne vais pas me charger inutilement. Par contre les sandalettes écorchées du bout repartent, parce qu'on ne sait jamais, si on n'en trouve plus. Et s'il y a de la place, on ajoutera quelques jouets. Pour leurs affaires, rien de changé : à l'aller comme au retour, elles gardent tout, plus quelques bricoles achetées au marché. Pépé est venu avec un si petit bagage qu'il n'a pas besoin de s'y prendre à l'avance. Mémé s'arrange avec la voisine de derrière. C'est entendu, elle lavera et repassera les draps, les taies, les serviettes de toilette et les torchons... moyennant finances. En rentrant Mémé murmure à Pépé : Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, la voisine. Drôles de mots ! Pépé assure que c'est de loin la meilleure solution pour vivre normalement jusqu'au moment de lui déposer la clef. A nouveau je pleure sans raison avouée, je ne veux pas qu'on la rende cette clef, je veux rester ici. Pépé me soulève, me prend dans ses bras et je dis le plus fort possible en me tournant vers Maman : "Je me suis tordu la cheville." "Quelle douillette cette gamine ! " s'exclame Maman. Pépé me regarde sans rien dire puis il me souffle : "Tu vas retrouver la Maison de Jouarre, ne pleure plus, on reviendra ici après la guerre. Nous sommes prêts. Mémé a arrêté le balancier de la pendule, a mis des vieux draps partout. Nous allons déposer la clef, c'est fini. Je sais qu'on ne reviendra jamais et j'inonde la collerette de ma robe de grosses larmes. Du retour, je ne me souviens de rien, preuve que cela s'est effectué sans incident ou preuve que ma tête a toujours refusé ce retour ? Pépé n'a pu tenir sa promesse de me ramener vers La Maison du Morvan parce qu'il est décédé quelques jours avant La Libération. Après notre départ, des réfugiés du Nord sont arrivés en masse. Le maire a réquisitionné notre maison. Les squatters venus les mains vides, sont repartis chez eux embarquant tout le contenu de la maison sous l'œil des villageois qui ont laissé faire. Certains ont même prêté des charrettes à bras pour faciliter le déménagement. La sœur de Mémé, la Grand'Tante Marie, dite aussi Marraine, s'est toujours opposée à la vente de la maison de ses parents. Personne n'allait jamais dans "ce trou perdu", surtout pas elle. Au fil des ans, sans aucun entretien, des fissures se sont formées, la toiture a laissé filtrer l'eau. Et puis un jour, le maire du village a écrit que cette bâtisse surplombant la route était menaçante et dangereuse. En 1958, alors que je gagnais 40000f par mois comme jeune institutrice débutante, la maison, la Maison du Morvan, a été bradée pour 56000f. Ce séjour est l'un de mes plus merveilleux souvenirs, un vrai coup de foudre d'une petite fille pour une maison.Montpellier, le 27 octobre 1999 |
| Claudette Prévot |