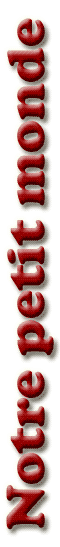![]()
 |
|||
| Enfance à Villemomble | |||
|
|||
Étrange vision |
|||
J'avais sept ans. Il paraît que c'est l'âge de raison ; peut-être, mais c'est sûrement l'âge où tu rêves le plus, où tu vis tout seul dans ton monde à toi. Donc j'avais sept ans, j'étais une élève brillante et j'aimais l'école passionnément. A cette époque, nous habitions une petite ville de banlieue, calme et tranquille. Chaque maison avait son jardin, ses quelques poules, ses quelques lapins et son chien. Une vie paisible malgré la guerre. La guerre, c'était pour nous l'absence de Papa à qui l'on écrivait tous les mois. Tous les enfants du quartier partaient ensemble, les grandes filles qui préparaient le Certificat d'Etudes surveillaient les plus jeunes et les aidaient à traverser la Grand'rue. Il fallait vingt bonnes minutes pour se rendre à l'école. Nous faisions ce trajet quatre fois par jour. Nous empruntions toujours le même chemin. En partant de la maison, nous longions la voie ferrée. Dans cette petite rue habitait un " vieux " de vingt ans. La fenêtre de sa cuisine, au premier étage, était ouverte toute l'année. Ses parents travaillaient sans arrêt, au jardin ou dans la maison. Mais, lui, le " vieux ", ne faisait jamais rien. Il restait immobile, des heures entières, assis, le coude droit posé sur la table de cuisine. Son seul travail semblait être de nous dire bonjour en agitant la main de gauche à droite devant son visage, le coude toujours posé. Il disait " bonjour, ça va ce matin ? ", puis continuait à regarder fixement les sureaux et les grands acacias cachant la voie ferrée. Il était grand, même assis. Il avait un visage long et très pâle, mais il nous souriait toujours, Nono Vanino. Tout le quartier savait que Nono était tuberculeux et que ses parents ne voulaient pas se séparer de leur fils unique. Nous disions donc bonjour quatre fois par jour à Nono qui nous le rendait. Cela a duré jusqu'au printemps. Ce matin, il fait un temps magnifique et les acacias en fleurs sentent bon. Je pense que Nono doit être bien content. Hors, depuis deux jours déjà, on n'a pas revu notre vieil ami. En cette fin d'après-midi, exceptionnellement, je rentre seule de l'école. Mon petit frère qui a une grosse otite est resté à la maison. Les grandes vont directement chez Pigier suivre des cours de sténo (Pigier a formé avec succès des générations de sténodactylos). Je rentre donc seule en faisant bien attention de ne pas marcher sur la ligne de séparation des bordures de trottoir, sinon j'ai perdu. Quand j'arrive devant chez Nono, il est là, comme d'habitude, mais il ne me dit pas bonjour, il ne parle pas, il n'agite pas la main ; seulement il me sourit d'un merveilleux sourire immobile dans son long visage si blanc si pâle... Je suis frappée par cette pâleur et je m'enfuis en courant... J'arrive toute essoufflée sur la petite place. Maman et les voisines y bavardent. Je crie : " Maman, Maman, Nono n'a pas dit bonjour ! " Et Maman me répond simplement : " Nous revenons de la chapelle, la cérémonie était très émouvante, Nono a été très entouré. " J'ai du mal à comprendre ce qu'elle me dit. Mais enfin, je l'ai vu, là, à l'instant... Je n'ose pas répéter tout haut que je l'ai vu. En semaine, quand les femmes du quartier disent qu'elles reviennent de la chapelle c'est qu'elles reviennent d'un enterrement Je me serre le long du corps de Maman ; les voisines critiquent les parents de Nono. Ces gens-là avaient les moyens d'envoyer leur fils unique à la montagne, non ! Au lieu de ça, ils l'ont laissé mourir dans cette cuisine sombre où la lumière brûle toute la journée ; un vrai scandale ! Et moi, je ne dis rien. Et moi, je suis sûre d'avoir vu ce sourire triste, ce sourire si triste et si beau. Mais les grandes personnes reviennent du cimetière... Pourtant, cinquante ans après, en racontant la disparition de Nono, je me sens bizarre, je me sens mal à l'aise et j'oserais presque murmurer : " il m'a fait un si beau sourire " ! Mais voyez- vous je ne le dirais pas, parce que maintenant je suis grand'mère et qu'une grand'mère, c'est sérieux, non ? ...ou c'est gâteux... Montpellier, le 15 Janvier 1995 |
| Claudette Prévot |